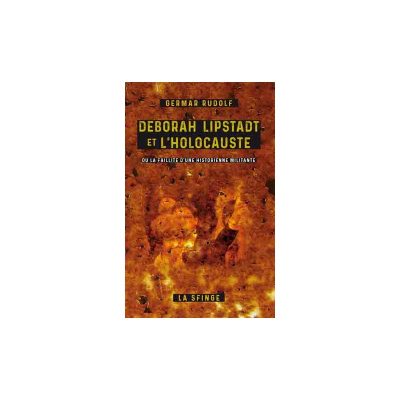Malgré la multitude de publication, le concept
d’ésotérisme reste encore flou. En effet, la lecture d’un grand nombre
de textes, destinés tant au grand public qu’au public averti, montre
qu’il existe encore dans l’esprit de certaines personnes des confusions
quant au sens à donner au mot « ésotérisme ». Ce flottement sémantique
et conceptuel s’explique par le fait que le monde universitaire s’est
montré jusqu’à présent peu réceptif à l’étude de cet objet : il n’est
devenu un objet universitaire, acquérant au passage une légitimité
scientifique, qu’entre 1950 et 1970.
Autre point répulsif, le contenu lexical de ce mot
est faible : il faut donc s’intéresser à sa fonction plutôt qu’à son
étymologie. En effet, l’ésotérisme recouvre un monde foisonnant, une
forme de pensée, souvent étrange au plus grand nombre. Pour certains, il
s’agit d’un terme « fourre-tout » ; pour d’autres, d’un discours
volontairement « crypté » ; d’un discours gnostique ; il peut aussi
s’agir d’un ésotérisme traditionaliste, d’un René Guénon ou d’un Julius
Evola – c’est de celui-ci dont il sera question dans cet article ; et
enfin, d’une approche universitaire, qui se penche surtout sur la
catégorie précédente.
L’ésotérisme
L’ésotérisme peut être analysé comme un mode
d’existence souterrain de visions du monde qui se veulent alternatives
aux savoirs « officiels ». C’est le sens que lui donne le sociologue
Jacques Maître. Toutefois, l’ésotérologue Antoine Faivre a bien montré
dans ses nombreux travaux qu’il faut écarter les définitions
paresseuses. L’une d’entre elle insiste sur l’idée de secret intrinsèque
à l’ésotérisme, c’est-à-dire de connaissances réservées. S’il n’est pas
illégitime d’employer ce mot dans ce sens-là, nous devons reconnaître
qu’il s’agit d’un sens extrêmement vague. De plus, la plupart des textes
ésotériques ne sont pas « secrets ». Enfin, le concept d’« ésotérisme »
est aussi confondu souvent avec la notion d’« initiation », ce qui
revient à lui faire dire n’importe quoi et surtout à le voir partout.
En effet, selon l’historien du catholicisme Émile
Poulat, l’ésotérisme n’est pas une doctrine d’initiés, mais un mode de
pensée accessible à tous. Son étrangeté vient surtout de notre ignorance
des conflits qui ont pu exister entre la foi et la science, entre la
pensée théologique et la pensée scientifique. D’après le chercheur
néerlandais Wouter Hanegraaff, l’ésotérisme ne serait qu’une religiosité
syncrétique née dans un contexte chrétien et dont les représentants
furent chrétiens jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ceux-ci,
insistaient d’ailleurs sur l’importance de la lumière intérieure ou
gnose : expérience par révélation qui amenait le plus souvent la
rencontre avec son moi véritable en même temps qu’avec la source de
l’être, Dieu.
Malgré cet aspect polymorphe, il a été possible
d’établir des critériologies synthétisant les différentes formes
occidentales d’imaginaires regroupées sous ce mot. La plus célèbre
d’entre elle reste celle d’Antoine Faivre. Celui-ci a défini six
caractéristiques fondamentales de l’ésotérisme dont les quatre premières
sont intrinsèques, c’est-à-dire que leur présence simultanée est une
condition nécessaire et suffisante pour définir l’ésotérisme. Les
cinquième et sixième éléments sont au contraire « secondaires,
c’est-à-dire non fondamentaux » :
1) La théorie des correspondances qui existeraient « entre toutes les parties de l’univers visible et invisible » ;
2) L’idée que la nature est un être vivant ;
3) L’importance attribuée à l’imagination et aux médiations des êtres surnaturels tels les anges ou les esprits ;
4) La théorie et l’expérience de la transmutation
selon laquelle l’Homme peut se transformer en quelque chose de supérieur
et de différent ;
5) « La pratique de la concordance », qui veut trouver des dénominateurs communs, souvent sous la forme d’une philosophia perennis, entre certaines traditions ou encore entre toutes les traditions qui sont souvent en quête d’une « Tradition primordiale » ;
6) L’idée de la transmission ininterrompue d’un
savoir ésotérique à travers les siècles, par filiation « régulière » ou
par « initiation » de maître à disciple.
Paradoxalement, ces deux dernières catégories, à
l’opposé des quatre éléments constitutifs précédemment définis par
Faivre, sont considérées par les ésotéristes comme les principales.
Cette critériologie est vite devenue une référence, ayant un double
avantage : 1) elle permet de diminuer les risques de confusions avec les
disciplines classiques dont les champs recoupent celui de l’ésotérisme
sans s’y confondre et 2) elle fait la part des fausses sciences que le
besoin croissant d’irrationnel multiplie, dont un certain nombre abuse
de l’appellation ésotérique. Néanmoins, certains chercheurs s’éloignent
de cette critériologie sur le point de la transmission, soulignant assez
justement que la pensée ésotérique développe dans l’histoire des idées
des modes spécifiques de transmission : oralité, relation
maître/disciple, initiation et, dans une moindre mesure, secret. En
effet, le terme « transmission » contient implicitement l’idée de
tradition : ce dernier mot vient du latin tradere qui signifie justement « transmettre ».
L’occultisme
Avant de nous pencher sur le cas de
la « Tradition », nous devons revenir sur un concept proche mais
distinct de l’ésotérisme, l’« occultisme ». Tous deux sont des
néologismes, apparus à la même époque. Ils sont d’ailleurs souvent
utilisés comme synonymes bien qu’ils soient de faux jumeaux. En effet,
il existe une distinction nette entre ce qui peut être défini comme
l’aspect théorique d’un côté (l’ésotérisme) et l’aspect pratique de
l’autre (l’occultisme). Cependant, comme l’ésotérisme, l’occultisme renvoie à une idée de secret. Dans le langage courant, le mot « occulte » (et ses dérivés)
renvoie à ce qui est caché, masqué. Il renvoie aussi à la fois à une
religiosité et à une forme de culture : l’occultisme fait non seulement
référence à une histoire, ou à une politique, qui serait cachée, mais
aussi à une série de pratiques sociologiques (la création de « sociétés
secrètes » et l’inscription de celles-ci dans une filiation continue) et
de pratiques magiques, de contact avec des entités supranaturelles et
de rites initiatiques.
Le mot occultisme fut révélé dès 1842 dans le Dictionnaire des mots nouveaux
de Jean-Baptiste de Radonvillers, mais ne fut réellement popularisé que
par l’occultiste socialisant Éliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant)
dans son livre Dogme et rituel de la haute magie. Citant Joseph de Maistre, Lévi nous dit que le comte
« avait prévu ce grand événement.
“Newton, disait-il, nous ramène à Pythagore, l’analogie qui existe entre
la science et la foi doit tôt ou tard les rapprocher. Le monde est sans
religion mais cette monstruosité ne saurait exister longtemps ; le
dix-huitième siècle dure encore, mais il va finir.” Partageant la foi et
les espérances de ce grand homme, nous avons osé fouiller les décombres
des vieux sanctuaires de l’occultisme ; nous avons demandé aux
doctrines secrètes des Chaldéens, des Égyptiens et des Hébreux, les
secrets de la transfiguration des dogmes, et la vérité éternelle nous a
répondu : la vérité, qui est une et universelle comme l’être ; la vérité
qui appartient à la science comme à la foi ; la vérité, mère de la
raison et de la justice ; la vérité vivante dans les forces de la
nature, les mystérieux Éloïm qui refont le ciel et la terre quand le
chaos a repris pour un temps la création et ses merveilles, et quand
l’esprit de Dieu plane seul sur l’abîme des eaux. La vérité est
au-dessus de toutes les opinions et de tous les partis ».
L’occultisme d’Éliphas Lévi découle en fait de la philosophia occulta développée par Cornelius Agrippa dans De Occulta Philosophia,
ouvrage paru en 1533. Ce terme sert alors à désigner un ensemble de
recherches et de pratiques portant sur des « sciences » telles que
l’astrologie, la magie, l’alchimie, la kabbale, etc. L’occultisme a donc
reçu en héritage les sciences occultes pratiquées pendant la
Renaissance. Cependant, ces « sciences » sont réinterprétées au travers
du savoir postrévolutionnaire. Cette réinterprétation a été rendue
nécessaire par l’échec partiel des Lumières. Le champ de cette philosophia occulta
va s’augmenter durant cette période des espaces laissés en friche par
la tentative de constituer une science catholique qui fit long feu,
profitant indirectement à l’occultisme. Sur ces bases, l’occultisme
s’est efforcé d’établir sa légitimité comme science des temps nouveaux
dans la première partie du siècle, et comme discipline autonome, à la
fin de la seconde, mais exercée dans le cadre de groupes semi-publics.
L’Âge d’or de l’occultisme, son apogée, a été la seconde moitié du très scientiste xixe
siècle avec des personnalités comme Éliphas Lévi, puis avec Papus
(Gérard Encausse), Joséphin Péladan, Helena Petrovna Blavatski, etc. Ces
occultistes, qui baignaient dans un romantisme postrévolutionnaire,
idéalisaient ouvertement un passé édénique et croyaient à l’avènement du
règne de l’esprit. Ils désiraient maintenir un espace ouvert entre la
science et le spirituel, allant à contre-courant de la sécularisation et
du scientisme croissants de leur siècle. En combinant les croyances,
ils pensaient à la fois amener la marche triomphale des sciences
génératrices de sécularisation et transfigurer l’univers matérialiste,
envisagé comme un retour universel aux origines. Cependant, les
occultistes étaient persuadés que certaines vérités spirituelles
devaient rester cachées dans des sanctuaires, la franc-maçonnerie et les
« sociétés secrètes », en attendant le moment propice de leurs
« désoccultation ».
René Guénon fera beaucoup pour distinguer l’occultisme, l’aspect
pratique, de l’ésotérisme, la théorisation. Selon lui, l’ésotérisme est
l’expression interne d’une doctrine traditionnelle. Par la suite, des
observateurs considéreront que l’ésotérisme se réduit à celui théorisé
par René Guénon, voire aux thèses qui sont interprétées à la lumière de
ses textes.
La « Tradition »
Comme les précédents termes étudiés, le mot
« tradition » est non seulement galvaudé mais il est également
polysémique. Dans le champ qui nous intéresse, il désigne entre autre la
transmission continue d’un contenu culturel à travers l’histoire depuis
un événement fondateur ou un passé immémorial. Il renvoie aussi aux us
et coutumes, à l’histoire, aux traditions populaires, bref ce qui est
hérité du passé et ce qui dure, la permanence. Cela s’oppose donc à la
nouveauté, au changement. En ce sens, ce mot peut être parfois synonyme
de « dépassé ». Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur
d’identité d’une communauté humaine. En ce sens, la tradition est une
forme de conscience collective : le souvenir de ce qui a été, avec le
devoir de le transmettre, de respecter cette transmission et de
l’enrichir. C’est le projet de la tradition au sens ésotérique. Au sens
religieux, métaphysique, la tradition est un corpus référentiel de
mythes, de textes ou de rites.
À la fois proche et distincte, la
signification au sens ésotérique du terme est celle que lui donnent les
représentants de la pensée dite traditionnelle (Guénon, Evola, Abellio,
Coomaraswamy, Lings, Schuon, Di Giorgio, Mordini, Nasr, etc.). Ce sens
développe l’idée d’une « unité transcendante des religions », pour
reprendre l’excellente expression de Frithjof Schuon. Trois postulats
constitue l’ésotérisme « traditionnel » : l’existence d’une « tradition
primordiale », c’est-à-dire antérieure à toutes les traditions locales ;
l’incompatibilité entre tradition et modernité ; et enfin la
possibilité de retrouver, partiellement, la « Tradition » par une
recherche des dénominateurs communs qui existeraient entre les
différentes traditions ainsi que par une ascèse intellectuelle et
spirituelle.
La « tradition primordiale » se présente donc comme une doctrine
métaphysique, supra-humaine immémoriale, relevant de la connaissance de
principes ultimes, invariables et universels. Ce discours est apparu
là-encore durant la Renaissance italienne, chez certains humanistes,
Marcile Ficin et Pic de la Mirandole notamment. Ces humanistes tentèrent
de chercher un dénominateur philosophico-religieux commun depuis les
philosophes païens en incorporant des éléments de religiosités
hellénistiques, stoïcisme, gnosticisme, hermétisme néo-alexandrin,
néo-pythagorisme, aux religions abrahamiques, les kabbales juive et
chrétienne, en passant par des éléments médiévaux. C’est alors que
naquit l’idée d’une
prisca theologia, d’une
philosophia occulta, d’une
philosophia perennis, ces expressions étant proches, mais non synonymes.
Cependant, le mot « Tradition » au sens ésotérique et moderne du
terme n’est apparu que sous l’influence de la Société Théosophique pour
désigner une
philosophia perennis élargie aux dimensions de tout
l’univers spirituel de l’humanité. Celle-ci fut ensuite énormément
transformée par l’ésotériste René Guénon qui remit de l’ordre dans la
définition théosophique, affirmant l’existence d’une « Tradition
primordiale », dont tous les courants ésotériques, franc-maçonnerie
comprise, et traditions religieuses en général ne seraient que des
formes dégradées plus ou moins reconnaissables.
La « tradition primordiale » devient, chez Guénon, la source première
et le fonds commun de toutes les formes traditionnelles particulières.
Cette distinction, apparaît dans son œuvre vers 1920. C’est cet
ésotérisme traditionaliste qui est appelé par les disciples de René
Guénon et de Julius Evola « Tradition », avec un « t » majuscule,
expression qui renvoie à la notion de « Tradition primordiale ». Cette
« Tradition », en tant que métaphysique, devient
la référence
absolue, à partir de laquelle est évalué le monde moderne dans tous ses
aspects. Elle se confond aussi, en partie, avec ce que les auteurs
anglo-saxons appellent le pérennialisme. Ce terme est fréquemment
employé par ceux-ci comme synonyme de « Tradition ». Il renvoie à la
notion de pérennité. Il a été vulgarisé par l’un des disciples les plus
connus de Guénon, Fritjhof Schuon, l’un des artisans du succès du
« néotraditionalisme ».
La méthode « traditionnelle »
Les partisans de cet ésotérisme traditionaliste ont développé une
méthode, qu’ils appliquent à l’étude des mythes, des religions et à
l’histoire des religions afin de montrer la pertinence de leur point de
vue. Cependant, la scientificité de la méthode traditionnelle est
contestée par des spécialistes de l’histoire des religions, ou par le
mythologue Mircea Eliade, pourtant considéré par les traditionalistes
eux-mêmes comme étant proche de leurs idées. D’ailleurs, Eliade
qualifia, dans des textes de jeunesse publiés dans les années trente,
Guénon de « prodigieux » et de « vrai maître ». Par la suite, lorsqu’il
deviendra un universitaire réputé, il ne reconnaîtra l’importance des
textes de Guénon et leur utilisation qu’en privé. Evola lui reprochera,
ayant été lui aussi en contact avec Eliade jusqu’au début des années
cinquante.
L’approche « traditionnelle » de
faire l’histoire des religions est une approche « religioniste » de
l’histoire des religions, c’est-à-dire que pour étudier et comprendre
une religion ou le fait religieux, il faut être soi-même religieux. En
l’occurrence, nos auteurs estiment qu’il faut croire à la « tradition
primordiale » si l’on veut que l’histoire des religions ait un sens.
Cette position est scientifiquement non tenable. Elle l’est d’autant
moins, que ceux-ci s’intéressent beaucoup plus aux ressemblances qu’aux
différences. Enfin, il ne faut pas oublier que la religion est un faux
objet naturel qui agrège des éléments très différents (ritualisme,
livres sacrés, sécularisation, émotions diverses, etc.) qui, à d’autres
époques, seront ventilés dans des pratiques très différentes et
objectivés par celles-ci sous des visages très différents. De fait, la
« Tradition », en tant que « science sacrée », a un caractère
foncièrement artificiel, très moderne, voire un aspect « mythique »
poussé. En fait, la « Tradition » est « bricolée », pour reprendre
l’expression de Lévi-Strauss, à partir de la vision irrationnelle de la
religion qu’a le traditionaliste de celle-ci et non à partir d’une
conception rationnelle, ce qui ne l’empêche pas d’être au demeurant une
structuration de type logique.
La « méthode traditionnelle » doit être plutôt vue comme
une construction intellectuelle essayant, plus ou moins intelligemment,
de donner une origine commune aux différentes traditions et
métaphysiques de l’humanité. En effet, la « Tradition » possède un
aspect empirique affirmé : les auteurs de la Renaissance précités ont
cherché un dénominateur commun à des traditions éloignées dans le temps
et l’espace, les différences étant considérées, par solution de
facilité, comme des dégradations dues aux évolutions divergentes d’un
même tronc.
Une vision antimoderne du monde… très moderne
La notion de « Tradition » découle
plus moins directement de l’idéologie contre-révolutionnaire, notamment
en ce qui concerne son antimodernité. En effet, les principaux
théoriciens de cette forme d’ésotérisme ont élaboré un discours faisant
de la modernité une involution polymorphe particulièrement néfaste.
Cette modernité honnie se caractériserait par différents aspects comme
l’individualisme, l’économisme, l’égalitarisme, le rationalisme,
l’humanisme, la révolution sexuelle, les fausses élites, le métissage,
la surpopulation, le totalitarisme, la dissolution de l’État, le
néo-spiritualisme, le biologisme, le matérialisme, le nationalisme, le
collectivisme, etc.
L’ésotérisme
traditionaliste est un ésotérisme ouvertement élitiste au niveau
spirituel, et cela dès son « recadrage », dans les années vingt par René
Guénon, puis par Julius Evola. Cette idée de dévolution apparaît chez
Guénon pour la première fois en 1927, dans La crise du monde moderne. Cette idée sera reprise en 1934, radicalisée, par Julius Evola dans sa Révolte contre le monde moderne.
Dans ce type de discours, la modernité devient une évolution aberrante,
une dévolution de la « Tradition primordiale », une aliénation
polymorphe absolue, un « âge sombre ». En effet, Guénon soutient qu’il
existe un long déclin de l’esprit depuis la Révélation primordiale.
Cette idée est au cœur de sa pensée. Celle-ci fut influencée par Joseph
de Maistre. Cela se ressent clairement dans ses essais. Nous retrouvons
dans ses textes les principaux thèmes antimodernes de la
contre-révolution, mais transférés dans le domaine ésotérique et
traditionaliste. Cela est aussi valable pour Evola. Ces influences sont
d’ailleurs reconnues par les traditionalistes eux-mêmes.
L’une de
leur influence est donc à chercher chez le penseur
contre-révolutionnaire Joseph de Maistre, bien que Maistre n’ait pas
utilisé le terme « ésotérisme », ce terme n’apparaissant qu’au début du
xixe siècle. Cependant, Maistre peut être vu dans une
certaine mesure comme un précurseur de la pensée ésotérique. Il
postulait que la « vraie religion », c’est-à-dire la philosophia perennis
précédemment décrite, est beaucoup plus ancienne que le christianisme.
En outre, Maistre chercha dans la Bible des doctrines, qui n’étaient pas
encore qualifiées d’« ésotériques ». Il se passionna aussi pour les
doctrines mystiques, pré-ésotériques dans un sens, du Suédois Emmanuel
Swedenborg. Evola considérait lui-même que le traditionalisme remontait à
Joseph de Maistre.
Assez
logiquement, des ésotéristes se sont donc réclamés de lui. Mais surtout
l’influence de Maistre se retrouve chez certains ésotéristes influents
du xixe siècle, notamment chez des ésotéristes issus
paradoxalement des rangs du socialisme utopique, tel Éliphas Lévi. À
partir de ce moment, les idées maistriennes, devenues omniprésentes, se
mélangeront aux corpus ésotériques. Cette synthèse a été d’autant plus
aisée que Joseph de Maistre s’est penché dans son œuvre sur des thèmes
proches de l’ésotérisme, comme l’illuminisme maçonnique, Maistre étant
lui-même franc-maçon et membre de sociétés initiatiques maçonniques et
paramaçonnique, notamment de l’Ordre des Élus Coëns de Martinès de
Pasqually.
Comme
l’idéologie contre-révolutionnaire, la pensée contre-révolutionnaire
s’étant construite en réaction aux Lumières des décennies avant la
Révolution française, la pensée traditionnelle dont elle découle, est
une création typiquement moderne : elle s’est construite comme un
décalque en miroir du monde moderne. Si la modernité peut être analysée
comme une avant-garde dont le mot d’ordre est de rompre avec la
tradition, l’antimodernité peut être définie en miroir, son mot d’ordre
étant de rompre avec la modernité pour renouer avec la tradition.
Paradoxalement, en faisant cela, les antimodernes se placent de facto
dans la modernité. Ils reprennent alors certains travers dont ils
inversent les caractéristiques. L’élaboration des corpus doctrinaux de
l’ésotérisme traditionaliste est donc dépendante de cette modernité.
Sans modernité, il n’y a pas de réaction traditionnelle. De plus, le
traditionalisme, dans son ensemble, et malgré ses vœux de revenir à une
société holiste, reste principalement une pratique individuelle : il
n’existe pas de grande structure traditionaliste. Le monde de
l’ésotérisme traditionaliste est un monde de divisions, de scissions, de
schismes, de brouilles, d’anathèmes… dans lequel l’individualisme,
expression de la modernité selon les traditionalistes, reste la norme.
Les rapports
entre les notions d’« ésotérisme » et de « Tradition » sont donc
complexes. Pour beaucoup, notamment parmi les traditionalistes et les
francs-maçons, les deux termes sont synonymes. La franc-maçonnerie a
joué un rôle important dans l’évolution des notions d’occulte,
d’ésotérique ou de secret ainsi que dans leurs confusions sémantiques
ultérieures. Les recherches universitaires ont permis de démêler
l’écheveau des significations et des amalgames. Cependant, ces
distinctions scientifiques n’ont pas encore été acceptées par tous, en
particulier dans les rangs des adeptes de la notion de « tradition
primordiale » et plus précisément chez les disciples de René Guénon.
Chez eux, l’œuvre de Guénon doit être continuée et non pas commentée. En
effet, en travaillant sur les distinctions entre « ésotérisme »,
« occultisme » et « Tradition », l’universitaire se place ipso facto dans la catégorie des commentateurs de Guénon, et devient donc suspect.