Michel de Pracontal
Deux chercheurs américains ont étudié les
gènes d’un échantillon de 40 populations du continent européen. Leur
verdict : tous les Européens d’aujourd’hui descendent des mêmes
ancêtres. Voilà pourquoi.
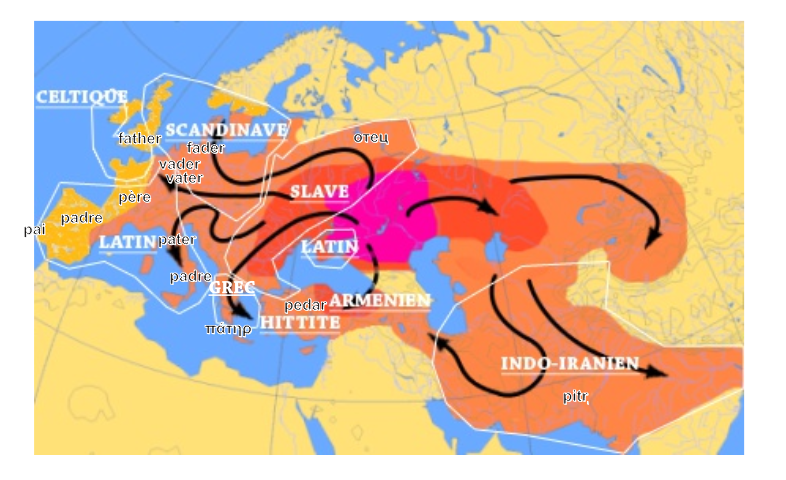
Prenez deux Européens d’aujourd’hui, même vivant dans des pays éloignés, par exemple un Finnois et un Français : ils ont toutes chances d’avoir de nombreux ancêtres communs ayant vécu il y a environ un millénaire. C’est ce que démontre une analyse des gènes de 2 257 personnes issues de 40 populations de l’ensemble du continent : Albanais, Anglais, Belges, Danois, Espagnols, Italiens, Macédoniens, Russes, Turcs, etc.
L’étude, qui vient de paraître dans Plos Biology, a été réalisé par deux généticiens des populations, Peter Ralph et Graham Coop (université de Californie à Davis). Elle montre qu’à l’échelle des 3 000 dernières années, il existe un degré de parenté élevé entre les populations des différentes nations européennes, en dépit du fait que celles-ci soient des constructions récentes, amalgamant des groupes humains différents.
Les deux chercheurs ont utilisé le génome complet des 2 257 individus étudiés. Ils ont recherché des segments d’ADN partagés par des individus différents. Le principe général est que deux individus qui ont un ancêtre commun peuvent partager un segment d’ADN hérité de cet ancêtre. Plus ce segment est long, plus l’ancêtre commun est récent. En analysant la longueur des segments d’ADN partagés par une paire d’individus, les chercheurs peuvent évaluer la distribution dans le temps de leurs ancêtres communs.
Mélange de segments courts et longs
Pourquoi y a-t-il une relation entre le temps et la longueur des segments d’ADN partagés par une paire d’individus ? Pour le comprendre, il faut considérer la manière dont les gènes, et par conséquent l’ADN qui est leur support matériel, se recombinent à chaque génération. Le génome d’un individu donné se forme en mélangeant les gènes de ses parents, de sorte que son ADN est constitué de segments venant de sa mère et d’autres de son père. A la génération suivante, le mélange intègre de nouveaux segments d’ADN, et ainsi de suite.
Ce processus se poursuit au fil des générations. De sorte que le génome d’une personne contient des segments de l’ADN de ses ancêtres, entrecoupés par les segments nouveaux introduits à chaque génération. Comme l’emplacement où les séquences d’ADN se modifient est différent à chaque fois, le résultat est que les segments conservés sont de plus en plus courts. Ainsi, des cousins germains au premier degré, qui ont des grand-parents communs, partageront des segments d’ADN plus longs que des cousins au deuxième degré ; ces derniers partageront des segments plus longs que des cousins au troisième degré, etc.
Si un segment hérité d’un ancêtre s’est conservé au bout d’un grand nombre de générations chez deux individus, on peut évaluer l’ancienneté de cet ancêtre à partir de la longueur du segment. C’est ce qu’ont fait Peter Ralph et Graham Coop. Leurs calculs montrent que deux Européens de deux pays voisins ont entre deux et douze "ancêtres génétiques" communs ayant vécu au cours des 1 500 dernières années ; et ils en ont jusqu’à une centaine si on remonte un millier de plus en arrière.
Des ancêtres communs
Aussi étonnant que cela paraisse, tous les habitants de l’Europe qui ont vécu il y a mille ans et qui ont eu des descendants sont eux-mêmes des ancêtres de tous les Européens d’aujourd’hui ! Ou si l’on préfère, tous les Européens contemporains descendent d’un même ensemble d’ancêtres ayant vécu il y a mille ans.
Les chercheurs ont cependant constaté que la répartition des ancêtres communs n’est pas homogène géographiquement : par exemple, les Italiens ont moins d’ancêtres génétiques communs entre eux et avec les autres Européens, et ont plus de liens avec des ancêtres remontant à 2 000 ans plutôt qu’à 1 000. Cette différence peut refléter un plus grand degré d’isolement géographique.
Mais les chercheurs reconnaissent eux-mêmes que pour étudier finement une histoire aussi complexe que celle de l’Europe, il ne suffit pas d’analyser les gènes des contemporains. Il faudra aussi utiliser des ADN d’individus ayant vécu dans le passé, dont on peut dater l’ancienneté. Et sans doute faire appel à d’autres disciplines, comme l’archéologie ou la paléo-anthropologie.
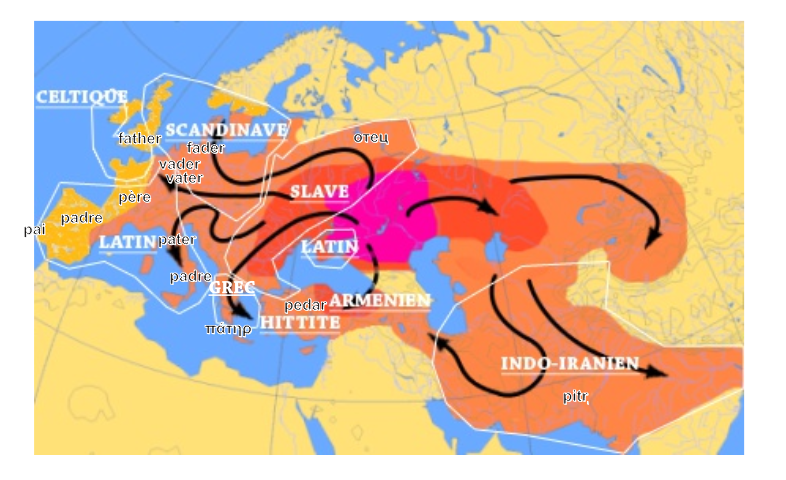
Prenez deux Européens d’aujourd’hui, même vivant dans des pays éloignés, par exemple un Finnois et un Français : ils ont toutes chances d’avoir de nombreux ancêtres communs ayant vécu il y a environ un millénaire. C’est ce que démontre une analyse des gènes de 2 257 personnes issues de 40 populations de l’ensemble du continent : Albanais, Anglais, Belges, Danois, Espagnols, Italiens, Macédoniens, Russes, Turcs, etc.
L’étude, qui vient de paraître dans Plos Biology, a été réalisé par deux généticiens des populations, Peter Ralph et Graham Coop (université de Californie à Davis). Elle montre qu’à l’échelle des 3 000 dernières années, il existe un degré de parenté élevé entre les populations des différentes nations européennes, en dépit du fait que celles-ci soient des constructions récentes, amalgamant des groupes humains différents.
Les deux chercheurs ont utilisé le génome complet des 2 257 individus étudiés. Ils ont recherché des segments d’ADN partagés par des individus différents. Le principe général est que deux individus qui ont un ancêtre commun peuvent partager un segment d’ADN hérité de cet ancêtre. Plus ce segment est long, plus l’ancêtre commun est récent. En analysant la longueur des segments d’ADN partagés par une paire d’individus, les chercheurs peuvent évaluer la distribution dans le temps de leurs ancêtres communs.
Mélange de segments courts et longs
Pourquoi y a-t-il une relation entre le temps et la longueur des segments d’ADN partagés par une paire d’individus ? Pour le comprendre, il faut considérer la manière dont les gènes, et par conséquent l’ADN qui est leur support matériel, se recombinent à chaque génération. Le génome d’un individu donné se forme en mélangeant les gènes de ses parents, de sorte que son ADN est constitué de segments venant de sa mère et d’autres de son père. A la génération suivante, le mélange intègre de nouveaux segments d’ADN, et ainsi de suite.
Ce processus se poursuit au fil des générations. De sorte que le génome d’une personne contient des segments de l’ADN de ses ancêtres, entrecoupés par les segments nouveaux introduits à chaque génération. Comme l’emplacement où les séquences d’ADN se modifient est différent à chaque fois, le résultat est que les segments conservés sont de plus en plus courts. Ainsi, des cousins germains au premier degré, qui ont des grand-parents communs, partageront des segments d’ADN plus longs que des cousins au deuxième degré ; ces derniers partageront des segments plus longs que des cousins au troisième degré, etc.
Si un segment hérité d’un ancêtre s’est conservé au bout d’un grand nombre de générations chez deux individus, on peut évaluer l’ancienneté de cet ancêtre à partir de la longueur du segment. C’est ce qu’ont fait Peter Ralph et Graham Coop. Leurs calculs montrent que deux Européens de deux pays voisins ont entre deux et douze "ancêtres génétiques" communs ayant vécu au cours des 1 500 dernières années ; et ils en ont jusqu’à une centaine si on remonte un millier de plus en arrière.
Des ancêtres communs
Aussi étonnant que cela paraisse, tous les habitants de l’Europe qui ont vécu il y a mille ans et qui ont eu des descendants sont eux-mêmes des ancêtres de tous les Européens d’aujourd’hui ! Ou si l’on préfère, tous les Européens contemporains descendent d’un même ensemble d’ancêtres ayant vécu il y a mille ans.
Les chercheurs ont cependant constaté que la répartition des ancêtres communs n’est pas homogène géographiquement : par exemple, les Italiens ont moins d’ancêtres génétiques communs entre eux et avec les autres Européens, et ont plus de liens avec des ancêtres remontant à 2 000 ans plutôt qu’à 1 000. Cette différence peut refléter un plus grand degré d’isolement géographique.
Mais les chercheurs reconnaissent eux-mêmes que pour étudier finement une histoire aussi complexe que celle de l’Europe, il ne suffit pas d’analyser les gènes des contemporains. Il faudra aussi utiliser des ADN d’individus ayant vécu dans le passé, dont on peut dater l’ancienneté. Et sans doute faire appel à d’autres disciplines, comme l’archéologie ou la paléo-anthropologie.











