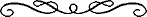[Ci-contre : Prof. Dr. phil. Ludwig Ferdinand Clauß en 1936]
Né le 8 février 1892 à Offenburg dans la région du Taunus, l’anthropologue Ludwig Ferdinand Clauss
est rapidement devenu l’un des raciologues et des islamologues les plus
réputés de l’entre-deux-guerres, cumulant dans son œuvre une approche
spirituelle et caractérielle des diverses composantes raciales de la
population européenne, d'une part, et une étude approfondie de la psyché
bédouine, après de longs séjours au sein des tribus de la
Transjordanie. L’originalité de sa méthode d'investigation raciologique a
été de renoncer à tous les zoologismes des théories raciales
conventionnelles, nées dans la foulée du darwinisme, où l’homme est
simplement un animal plus évolué que les autres. Clauss renonce aux
comparaisons trop faciles entre l’homme et l’animal et focalise ses
recherches sur les expressions du visage et du corps qui sont
spécifiquement humaines ainsi que sur l’âme et le caractère.
Il
exploite donc les différents aspects de la phénoménologie pour élaborer
une raciologie psychologisante (ou une “psycho-raciologie”) qui conduit
à comprendre l’autre sans jamais le haïr. Dans une telle optique,
admettre la différence, insurmontable et incontournable, de l’Autre,
c'est accepter la pluralité des données humaines, la variété des façons
d'être-homme, et refuser toute logique d'homologation et de
centralisation coercitive.
Ludwig Ferdinand Clauss était un disciple
du grand philosophe et phénoménologue Edmund Husserl. Il a également
été influencé par Ewald Banse (1883-1953), un géographe qui avait étudié
avant lui les impacts du paysage sur la psychologie, de l’écologie sur
le mental. Ses théories cadraient mal avec celles, biologisantes, du
national-socialisme. Les adversaires de Clauss considéraient qu'il
réhabilitait le dualisme corps/âme, cher aux doctrines religieuses
chrétiennes, parce que, contrairement aux darwiniens stricto sensu,
il considérait que les dimensions psychiques et spirituelles de l’homme
appartenaient à un niveau différent de celui de leurs caractéristiques
corporelles, somatiques et biologiques. Clauss, en effet, démontrait que
les corps, donc les traits raciaux, étaient le mode et le terrain
d'expression d'une réalité spirituelle/psychique. En dernière instance,
ce sont donc l’esprit (Geist) et l’âme (Seele) qui
donnent forme au corps et sont primordiaux. D'après les théories
post-phénoménologiques de Clauss, une race qui nous est étrangère,
différente, doit être évaluée, non pas au départ de son extériorité
corporelle, de ses traits raciaux somatiques, mais de son intériorité
psychique. L’anthropologue doit dès lors vivre dans l’environnement
naturel et immédiat de la race qu'il étudie. Raison pour laquelle
Clauss, influencé par l’air du temps en Allemagne, commence par étudier
l’élément nordique de la population allemande dans son propre biotope,
constatant que cette composante ethnique germano-scandinave est une
“race tendue vers l’action” concrète, avec un élan froid et un souci des
résultats tangibles. Le milieu géographique premier de la race nordique
est la Forêt (hercynienne), qui recouvrait l’Europe centrale dans la
proto-histoire.
La
Grande Forêt hercynienne a marqué les Européens de souche nordique
comme le désert a marqué les Arabes et les Bédouins. La trace littéraire
la plus significative qui atteste de cette nostalgie de la Forêt
primordiale chez les Germains se trouve dans le premier livre évoquant
le récit de l’Évangile en langue germanique, rédigé sous l’ordre de
Louis le Pieux. Cet ouvrage, intitulé le Heliand (Le Sauveur), conte, sur un mode épique très prisé des Germains
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, les épisodes de la vie de
Jésus, qui y a non pas les traits d'un prophète proche-oriental mais
ceux d'un sage itinérant doté de qualités guerrières et d'un charisme
lumineux, capable d'entraîner dans son sillage une phalange de disciples
solides et vigoureux. Pour traduire les passages relatifs à la retraite
de 40 jours que fit Jésus dans le désert, le traducteur du Haut Moyen
Âge ne parle pas du désert en utilisant un vocable germanique qui
traduirait et désignerait une vaste étendue de sable et de roches,
désolée et infertile, sans végétation ni ombre. Il écrit sinweldi,
ce qui signifie la “forêt sans fin”, touffue et impénétrable, couverte
d'une grande variété d'essences, abritant d'innombrables formes de vie.
Ainsi, pour méditer, pour se retrouver seul, face à Dieu, face à la
virginité inconditionnée des éléments, le Germain retourne, non pas au
désert, qu'il ne connaît pas, mais à la grande forêt primordiale. La
forêt est protectrice et en sortir équivaut à retourner dans un “espace
non protégé” (voir la légende du noble saxon Robin des Bois et la
fascination qu'elle continue à exercer sur l’imaginaire des enfants et
des adolescents).
L’idée
de forêt protectrice est fondamentalement différente de celle du désert
qui donne accès à l’Absolu : elle implique une vision du monde plus
plurielle, vénérant une assez grande multiplicité de formes de vie
végétale et animale, coordonnée en un tout organique, englobant et
protecteur.
L’homo europeus ou germanicus
n’a toutefois pas eu le temps de forger et de codifier une spiritualité
complète et absolue de la forêt et, aujourd'hui, lui qui ne connaît pas
le désert de l’intérieur, au contraire du Bédouin et de l’Arabe, n’a
plus de forêt pour entrer en contact avec l’Inconditionné. Et quand Ernst Jünger parle de “recourir à la forêt”, d'adopter la démarche du Waldgänger,
il formule une abstraction, une belle abstraction, mais rien qu'une
abstraction puisque la forêt n’est plus, si ce n’est dans de lointains
souvenirs ataviques et refoulés. Les descendants des hommes de la forêt
ont inventé la technique, la mécanique (L. F. Clauss dit la Mechanei),
qui se veut un ersatz de la nature, un palliatif censé résoudre tous
les problèmes de la vie, mais qui, finalement, n’est jamais qu'une
construction et non pas une germination, dotée d'une mémoire intérieure
(d'un code génétique). Leurs ancêtres, les Croisés retranchés dans le
krak des Chevaliers,
avaient fléchi devant le désert et devant son implacabilité. Preuve que
les psychés humaines ne sont pas transposables arbitrairement, qu'un
homme de la Forêt ne devient pas un homme du Désert et vice-versa, au
gré de ses pérégrinations sur la surface de la Terre.
À terme, la spiritualité du Bédouin développe un “style prophétique” (Offenbarungsstil),
parfaitement adapté au paysage désertique, et à la notion d'absolu
qu'il éveille en l’âme, mais qui n’est pas exportable dans d'autres
territoires. Le télescopage entre ce prophétisme d'origine arabe,
sémitique, bédouine et l’esprit européen, plus sédentaire, provoque un
déséquilibre religieux, voire une certaine angoisse existentielle,
exprimée dans les diverses formes de christianisme en Europe.
Clauss
a donc appliqué concrètement — et personnellement — sa méthode de
psycho-raciologie en allant vivre parmi les Bédouins du désert du
Néguev, en se convertissant à l’islam et en adoptant leur mode de vie.
Il a tiré de cette expérience une vision intérieure de l’arabité et une
compréhension directe des bases psychologiques de l’islam, bases qui
révèlent l’origine désertique de cette religion universelle.
Sous le IIIe
Reich, Clauss a tenté de faire passer sa méthodologie et sa théorie des
caractères dans les instances officielles. En vain. Il a perdu sa
position à l’université parce qu'il a refusé de rompre ses relations
avec son amie et collaboratrice Margarete Landé [depuis 1925],
de confession israélite, et l’a cachée jusqu'à la fin de la guerre.
Pour cette raison, les autorités israéliennes ont fait planter un arbre
en son honneur à Yad Vashem en 1979. L’amitié qui liait Clauss à
Margarete Landé ne l’a toutefois pas empêché de servir fidèlement son
pays en étant attaché au Département VI C 13 du RSHA (Reichssicherheitshauptamt), en tant que spécialiste du Moyen-Orient.
Après la chute du IIIe
Reich, Clauss rédige plusieurs romans ayant pour thèmes le désert et le
monde arabe, remet ses travaux à jour et publie une étude très
approfondie sur l’islam, qu'il est un des rares Allemands à connaître de
l’intérieur. La mystique arabe/bédouine du désert débouche sur une
adoration de l’Inconditionné, sur une soumission du croyant à cet
Inconditionné. Pour le Bédouin, c'est-à-dire l’Arabe le plus
authentique, l’idéal de perfection pour l’homme, c'est de se libérer des
“conditionnements” qui l’entravent dans son élan vers l’Absolu. L’homme
parfait est celui qui se montre capable de dépasser ses passions, ses
émotions, ses intérêts. L’élément fondamental du divin, dans cette
optique, est l’istignâ, l’absence totale de besoins. Car Dieu,
qui est l’Inconditionné, n’a pas de besoins, il ne doit rien à personne.
Seule la créature est redevable : elle est responsable de façonner sa
vie, reçue de Dieu, de façon à ce qu'elle plaise à Dieu. Ce travail de
façonnage constant se dirige contre les incompétences, le laisser-aller,
la négligence, auxquels l’homme succombe trop souvent, perdant
l’humilité et la conscience de son indigence ontologique. C'est contre
ceux qui veulent persister dans cette erreur et cette prétention que
l’islam appelle à la Jihad. Le croyant veut se soumettre à
l’ordre immuable et généreux que Dieu a créé pour l’homme et doit lutter
contre les fabrications des “associateurs”, qui composent des arguments
qui vont dans le sens de leurs intérêts, de leurs passions mal
dominées. La domination des “associateurs” conduit au chaos et au
déclin. Réflexions importantes à l’heure où les diasporas musulmanes
sont sollicitées de l’intérieur et de l’extérieur par toutes sortes de
manipulateurs idéologiques et médiatiques et finissent pas excuser ici
chez les leurs ce qu'ils ne leur pardonneraient pas là-bas chez elles.
Clauss a été fasciné par cette exigence éthique, incompatible avec les
modes de fonctionnement de la politicaille européenne conventionnelle.
C'est sans doute ce qu'on ne lui a pas pardonné.
Ludwig
Ferdinand Clauss meurt le 13 janvier 1974 à Huppert dans le Taunus.
Considéré par les Musulmans comme un des leurs, par les Européens
enracinés comme l’homme qui a le mieux explicité les caractères des
ethnies de base de l’Europe, par les Juifs comme un Juste à qui on rend
un hommage sobre et touchant en Israël, a récemment été vilipendé par
des journalistes qui se piquent d'anti-fascisme à Paris, dont Denis Schérer,
qui utilise le pseudonyme de “René Monzat”. Pour ce Schérer-Monzat (1),
Clauss, raciologue, aurait été tout bonnement un fanatique nazi,
puisque les préoccupations d'ordre raciologique ne seraient que le fait
des seuls tenants de cette idéologie, vaincue en 1945. Schérer-Monzat
s’avère l’une de ces pitoyables victimes du manichéisme et de
l’inculture contemporains, où la reductio ad Hitlerum devient
une manie lassante. Au contraire, Clauss, bien davantage que tous les
petits écrivaillons qui se piquent d'anti-fascisme, est le penseur du
respect de l’Autre, respect qui ne peut se concrétiser qu'en replaçant
cet Autre dans son contexte primordial, qu'en allant à l’Autre en
fusionnant avec son milieu originel. Édicter des fusions, brasser dans
le désordre, vouloir expérimenter des mélanges impossibles, n’est pas
une preuve de respect de l’altérité des cultures qui nous sont
étrangères.
► Robert Steuckers.
• note en sus :
1. cf. encadré à ce sujet paru dans éléments n°89, 1997, p. 7. Dénis Schérer,
incidemment fils du cinéaste Éric Rohmer (Maurice Schérer de son vrai
nom) et neveu du philosophe René Schérer, aura toujours compensé son
absence de talent par une vocation de sycophante.
L'agitation-propagande, définie par Trotsky comme devant faire «
bouillir l’énergie révolutionnaire » auprès des ouvriers en leur rendant
plus vives les contradictions d’une société, s'est travestie de manière
perverse, chez cet ancien de la LCR, en maniaquerie de la compilation
de presse afin de fabriquer un épouvantail servant de
personnage-repoussoir, imaginant ainsi propager la peur auprès d’une
opinion publique secrètement méprisée. Contrairement aux véritables
lanceurs d'alerte, le sycophante ne dérange strictement en rien les
puissants, il n'informe pas mais déforme, il se complait dans la
stérilité. C’est pourquoi les sycophantes resteront irrévocablement des «
idiots utiles » (expression attribuée à Lénine) du capital. Finalement,
ce ne sont que des concierges qui attendent un pourboire pour éviter
les regrets de ne jamais avoir pu devenir des faux-monnayeurs assumés.
♦ Bibliographie :
- Die nordische Seele : Artung, Prägung, Ausdruck, 1923
- Rasse und Seele : Eine Einführung in die Gegenwart, 1926
- Fremde Schönheit. Eine Betrachtung seelischer Stilgesetze, 1928
- Von Seele und Antlitz der Rassen und Volker, 1929 [recension]
- Als Beduine unter Beduine, 1931
- Die nordische Seele, 1932 [recension]
- Rassenseelenforschung im täglichen Leben, 1934
- Vorschule der Rassenkunde auf der Grundlage praktischer Menschenbeobachtung, 1934 (avec Arthur Hoffmann)
- Rasse und Charakter, Erster Teil : Das lebendige Antlitz, 1936 (la deuxième partie n’est pas parue)
- Rasse ist Gestalt, 1937
- Semiten der Wüste unter sich : Miterlebnisse eines Rassenforschers, 1937
- Rasse und Seele : Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt, 1937
- Rassenseele und Einzelmensch, 1938
- Die nordische Seele : Eine Einführung in die Rassenseelenkunde, 1940 (édition révisée)
- König und Kerl, 1948 (œuvre dramatique)
- Thuruja, 1950 (roman)
- Verhüllte Häupter, 1955 (roman)
- Die Wüste frei machen, 1956 (roman)
- Die Seele des Andern : Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenland, 1958
- Flucht in die Wüste, 1960-63 (version pour la jeunesse de Verhüllte Häupter)
- Die Weltstunde des Islams, 1963
- « David et Goliath » in : Études et Recherches n°2 (nouvelle série), 1983 [lire plus bas]
♦ Sur Ludwig Ferdinand Clauss :
- Julius Evola, Il mito del sangue, Ar, Padoue, 1978 (tr. fr. : Le mythe du sang, éd. de l’Homme Libre, 1999)
- Julius Evola, « F. L. Clauss : Rasse und Charakter », recension dans Bibliografia fascista, Anno 1936-XI (repris dans J. Evola, Esplorazioni e disamine : Gli scritti di “Bibliografia fascista”, Vol. I, 1934-IX - 1939-XIV, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parma, 1994)
- Léon Poliakov/Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker : Dokumente und Berichte, Fourier, Wiesbaden, 1989 (2ème éd.) (Poliakov et Wulf reproduisent un document émanant du Dr. Walter Gross et datant du 28 mars 1941, où il est question de mettre Clauss à l’écart et de passer ses œuvres sous silence parce qu'il n’adhère pas au matérialisme biologique, parce qu'il est « vaniteux » et qu'il a une maîtresse juive)
De récents travaux insistent sur la prétendue ambiguïté tant existentielle qu’idéologique de LFC dans le but d'établir que les théories racialistes de LFC seraient plus une contrepartie au national-socialisme qu'un contrepoint. Signalons entre autres la biographie de Peter Weingart (Doppel-Leben - Ludwig Ferdinand Clauss : Zwischen Rassenforschung und Widerstand, 1995) [recension] ou encore cette étude par Felix Wiedemann (« The North, the Desert, and the Near East : LF Clauß and the Racial Cartography of the Orient », in : Studies in Ethicity and Nationalism n°2/1992) schématisant Clauss par un subtil triangle : Occident et Orient, dichotomiques, en seraient la base, laissant le Juif, entité abstraite atopique, comme tiers exclu. Or, en écartant toute surinterprétation, il n'est pas inutile de rappeler que ce domaine de recherches, initié au XIXe siècle avec la psychologie des peuples, n'est pas spécifiquement allemand : plaquer l'historique sur l'épistémologique conduit à implicitement idéologiser le débat. De la tonalité völkisch imprégnant certains écrits anthropologiques de Clauss, il n'est pas probant d'inférer que cela conduise nécessairement à une logique d'appareil d'État totalitaire nonobstant l'exploitation démagogique de ces thèmes par ce dernier. La politique comme pure gestion des masses est même aux antipodes de toute considération des peuples comme matrice des différences (cf. entrée ethnocide). Une humanité indifférenciée, démobilisée politiquement mais exploitable, est le pendant d'un capitalisme néo-libéral pour lequel il n'y a ni privé ni public mais seulement reconfiguration des flux utiles à son extension.

•
Avertissement : La notice biographique ci-haut reprenait en grande
partie l’article ci-dessous. Nous le reproduisons ici à fin d'archivage.
[Ci-contre : couverture de Araber des Ostens,
Nürnberg, Luken & Luken, 1949. La piété musulmane y est définie
comme une spiritualisation des lois du désert. Cette approche
psycho-anthropologique le distingue de celle sociologique de Gustave Le Bon (Lois psychologiques de l’évolution des peuples ; La civilisation des Arabes)
qui considère « l’âme collective », perdurant par-delà les différentes
formes extérieures prises, comme âme des races, c'est-à-dire «
l’ensemble des caractères communs imposés par le milieu et l’hérédité à
tous les individus d'un peuple », . Autrement dit, le facteur racial est
considéré comme fondamental dans la formation des idées et croyances
alors que chez Clauss il n’est qu'une base matérielle que transcende la
dynamique des mentalités, ce que Evola retiendra dans l’élaboration de
son anthropologie spirituelle distinguant « race du corps » et « race de l’âme »]
Né
le 8 février 1892 à Offenburg dans le Pays de Bade et décédé le 13
janvier 1974 à Huppert dans la région du Taunus, Ludwig Ferdinand
Clauss, professeur à Berlin quand il résidait en Allemagne, n’a jamais
cessé de voyager dans les pays arabes, a été fasciné par la majesté du
désert et a résidé chez les Bédouins de ce que l’on appelait à l’époque
la Transjordanie ; il a pérégriné avec eux et est devenu Muhammad Ferîd
el-Almâni.
Disciple
de Husserl et adepte de sa phénoménologie, Clauss développe une
anthropologie racialisée et psychologisante (une “psycho-raciologie”
serait-on tenté de dire) qui renonce aux méthodes “zoologiques” et
accepte l’autre tel qu'il est, veut le comprendre, veut comprendre sa
façon d'agir et sa culture. Ses intérêts et l’air du temps le portent à
étudier la psychologie de la “race nordique”, tendue et mobilisée
entièrement vers l’action. Ensuite, tous ses efforts se portent vers des
études approfondies de la “race bédouine”, “race du désert” ou “race
arabe”, race portée vers l’absolu et vers les révélations, qui donne au
monde des prophètes enthousiastes et conquérants. Ses expériences
arabes/bédouines sont consignées dans plusieurs ouvrages : Als Beduine unter den Beduinen (1931), Semiten der Wüste unter sich (1937), Araber des Ostens (1943), le roman Flucht in die Wüste (1960) et, enfin, Die Weltstunde des Islams
(1963), où il résume de manière didactique sa vision de l’arabité et de
l’islam, cherchant à en communiquer le message aux Occidentaux.
Die Weltstunde des Islams
se subdivise en quatre parties, analysant, notamment, les racines de
l’arabité, les éléments perpétuellement vivants en islam, la force du
désert et l’avenir de l’islam.
L’islam
est une religion qui commence par l’histoire d'un homme qui est allé
dans le désert, pour y rencontrer Dieu, l’Absolu, l’Infini. C'est la
démarche de l’ermite qui va volontairement dans l’éremos ou l’eremia
(termes grecs pour désigner le désert) ; pour les Arabes, c'est là une
démarche volontaire et non naturelle : le Bédouin, lui, est du désert ;
il n’y va pas ; il en vient. Il est bádawi et vient du bâdiye.
Le désert est terrible : il impose aux hommes sa loi ; ceux qui la
suivent, survivent ; ceux qui ne la suivent pas, se détruisent
eux-mêmes. Mais cette rigueur implique aussi le devoir de protection, la
dachâla : si, dans son combat incessant avec le désert, un
homme demande la protection d'un autre, en lui disant “je suis ton
protégé”, le protecteur doit accepter ce rôle, même si le demandeur est
l’ennemi de sa tribu voire son ennemi personnel. Cette règle ne tolère
aucune exception, même si aucune autorité politique ne viendra
sanctionner son infraction. Le Bédouin est libre. Inconditionnellement
libre. Il adore, en son cœur profond, l’Inconditionné et s’y soumet,
lui, qui, comme tous les hommes, est conditionné par les circonstances,
par ses passions, par les passions des siens. L’idéal, l’homme parfait,
est, pour lui, celui qui se montre capable de se libérer des
“conditions” : circonstances, passions, émotions, intérêts. L’islam, en
tant que religion, repose sur cet amour de l’Inconditionné.
Car l’élément fondamental du divin, c'est l’istignâ,
l’absence totale de besoins. Dieu, l’Inconditionné, n’a pas de besoins,
il ne doit rien à personne. Seule la créature est redevable : elle est
responsable de façonner sa vie, reçue de Dieu, de façon à ce qu'elle
plaise à Dieu. Ce travail de façonnage constant se dirige contre les
intempérances, le laisser-aller, la négligence, auxquels l’homme
succombe trop souvent, perdant l’humilité et la conscience de son
indigence ontologique.
C'est contre ceux qui veulent persister dans cette erreur et cette prétention que l’islam appelle à la Jihad.
Car ces écervelés prétentieux sont dirigés par leurs passions,
n’agissent que dans leurs intérêts, ne respectent pas les autres, se
dissocient des leurs, fabriquent des arguments qui vont dans le sens de
leurs intérêts matériels, sont des “associateurs”. Si le monde est
gouverné par de tels “insoumis”, des insoumis aux lois du réel, dont
l’islam est l’expression religieuse, il basculera dans le chaos et dans
le déclin. La Jihad lutte contre ce chaos, contre les
“associateurs” qui répandant le chaos, au lieu de se soumettre à l’ordre
immuable et généreux qui les protège, eux et tous les autres hommes, et
leur apporte le nécessaire.
Certes,
l’Europe et les Européens, qui relèvent de caractériologies raciales
radicalement différentes, n’ont pas l’expérience du désert. Ils
viennent, explique L.F. Clauss, du pays des forêts (pp. 119-126). Ce qui
les marque tout aussi profondément que le désert marque les Arabes. Les
Indo-Iraniens ne se sont habitués au désert qu'après de longues
générations. Quand l’histoire de Jésus, qui, lui aussi, recourt au
désert et y séjourne 40 jours, est publiée pour la première fois en une
langue germanique, dans le Heliand que Louis le Pieux fait
rédiger à l’usage des Saxons fraîchement convertis de force par les
armées de Charlemagne, l’auteur ne traduit pas le mot “désert” par un
équivalent germanique qui désignerait une vaste étendue de sable désolée
et infertile, sans végétation ni ombre. Il écrit sinweldi, la
forêt sans fin. Pour méditer, pour retourner à Dieu, à la virginité
inconditionnée des éléments, l’Européen, le Celte, le Germain ou le
Slave, retourne, non pas au désert, mais à la forêt primordiale. La
forêt est protectrice et en sortir équivaut à retourner dans un “espace
non protégé”. L’idée de forêt protectrice est fondamentalement
différente de celle du désert qui donne accès à l’Absolu ; elle implique
une vision du monde plus plurielle, vénérant une assez grande
multiplicité des essences, mais une multiplicité coordonnée en un tout
organique. Mais l’homo europeus n’a pas eu le temps de créer
une spiritualité absolue de la forêt et, aujourd'hui, lui qui ne connaît
pas le désert de l’intérieur, n’a plus de forêt pour entrer en contact
avec l’Inconditionné. Et quand Ernst Jünger parle de “recourir à la
forêt”, d'adopter la démarche du Waldgänger, il formule une abstraction, une bel-le abstraction, mais rien qu'une abstraction puis-que la forêt n’est plus.
Les descendants des hommes de la forêt ont inventé la technique, la mécanique (L.F. Clauss dit : die Mechanei).
Leurs ancêtres, les Croisés retranchés dans le krak des Chevaliers,
avaient fléchi devant le désert et devant son implacabilité. La question
qui se pose depuis quelques décennies au monde arabo-musulman, surtout
depuis la récente guerre du Golfe : le désert, implacable et
inconditionné, va-t-il fléchir devant la technique des descendants des
hommes de la forêt, qui n’ont plus de forêt ? Or la technique produit
principalement de “l’avoir”, ce qui est sa faiblesse ontologique ;
l’Occidental, par le truchement de sa technique, fabrique des choses
qu'il possède, collectionne, amasse, sans pour autant fortifier son
être, limiter son indigence ontologique, limiter ses besoins au minimum
pour être plus proche, plus semblable au divin qui se passe de besoins.
L’Oriental, islamique ou non, succombe très souvent, et avec une
facilité déconcertante, aux séductions de “l’avoir”, reniant ce sens
fortifiant de l’humilité devant l’Inconditionné, qui avait fait sa force
en tant que vecteur de la civilisation islamique. En Europe
occidentale, les séductions du règne de l’a-voir fait des ravages dans
les rangs des hommes du désert immigrés dans le pays de la forêt qui
n’est plus. Si bien qu'on peut dire, en bien des cas, que ceux-ci ne
sont plus des hommes de l’islam, de la soumission, de l’humilité et de
l’ascèse.
Au-delà
des origines, l’avenir appartient à ceux qui ne se laisseront pas
séduire par les choses éphémères mais à ceux qui fortifieront l’Être. Et
inaugureront un nouveau Règne de l’Être.
♦ Ludwig Ferdinand Clauss, Die Weltstunde des Islams, Verlag Neues Forum, Schweinfurt, 1963.
► Robert Steuckers, Vouloir n°89/92, 1992.

pièce-jointes :
Chaque
fois qu’une nouveauté surgit dans l’histoire, les clameurs ne se font
pas attendre. Ce que la recherche allemande en racio-psychologie a dû
affronter, un certain temps en Allemagne même, fut en réalité le lot de
toute la raciologie allemande de la part du reste du monde. Les
reproches les plus inouïs lui furent adressés. La plupart étaient
d'ailleurs si niais que le temps en fit rapidement litière. Peu à peu
cependant, les armes dirigées contre nous s’affinèrent. Mais, toujours,
la question des valeurs fut au centre de l’argumentaire qui devait nous
abattre. On nous accusa de tenir la race nordique pour la seule valable,
toutes les autres étant supposées l’être moins... Là où cet “argument”
fut cru, il nous fit d'autant plus de mal que l’épithète “nordique”, à
l’origine de tant de méprises chez le profane, se prête à toutes sortes
de manipulations gratuites, allant de la malhonnêteté à la bêtise.
Le
Vatican, hélas, joignit sa voix aux vociférations contre les acquis de
la raciologie. Il nous attaqua en particulier, avec les arguments
habituels, dans un article de l’Osservatore Romano du 30 avril
1938. Comme mes livres furent également la cible de ces attaques, il est
de mon devoir, me semble-t-il, de mettre ici les choses au point en
quelques lignes, tout au moins en ce qui me concerne. Même si ces propos
anticipent sur le contenu de l’ouvrage qu'ils sont censés préfacer.
Il
y a trois erreurs par lesquelles ces attaques essaient de nous
brouiller avec nos voisins. La première consiste à donner l’impression
que la raciologie allemande attribuerait à chaque race, comme le maître à
ses élèves, un rang déterminé. Selon cette erreur, elle assignerait
ainsi une place à chaque race, la première revenant à la race nordique.
Ce qui impliquerait que la race méditerranéenne, par exemple, dût se
contenter de la seconde, ou d'une place inférieure encore.
Rien
n’est plus faux. Certes, des livres et des brochures, parus en
Allemagne et à l’étranger, ont affirmé cela. Mais la racio-psychologie,
dont la seule mission, en fin de compte, est de déterminer les valeurs
liées à l’âme de telle ou telle race, nous enseigne d'emblée, très
explicitement, que chaque race représente en elle-même et pour elle-même
la valeur suprême. Chaque race porte son ordre et ses critères de
valeurs. Elle ne peut être appréciée au moyen des critères d'une autre
race. Il est donc absurde et de surcroît anti-scientifique de voir, par
ex., la race méditerranéenne avec les yeux de la race nordique et de
porter sur elle un jugement de valeur selon des critères nordiques — et
l’inverse est tout aussi vrai. Bien sûr, de telles bévues se produisent
sans cesse dans la vie quotidienne, et c'est inévitable. Mais pour la
science, c'est là un manquement à la logique la plus élémentaire.
Pour
juger “objectivement” de la valeur d'une race humaine, il faudrait être
au-dessus de toutes les races ! Chose impossible car être homme, c'est
être déterminé par des caractères raciaux. Dieu, peut-être, a-t-il son
échelle de valeurs. Pas nous. La science a donc pour mission de trouver
la loi qui gouverne la constitution physique et mentale de chaque race.
Cette loi particulière renferme également le système de valeurs
spécifique, inhérent à cette race. On peut comparer ces systèmes de
valeurs : l’échelle de valeurs spécifique à la race nordique, par ex.,
peut être comparée à celle de la race méditerranéenne. Ces comparaisons
sont même instructives car toute chose, dans le monde où nous vivons, ne
dévoile sa nature que si elle se distingue d'une autre, différente.
Mais ces ordres de valeurs ne peuvent être jugés “en soi”, à partir
d'une axiologie “surplombante” puisqu'une telle axiologie, à notre
connaissance, n’existe pas.
Que
le Nordique soit nordique et le Méditerranéen méditerranéen ! Car ce
n’est que si l’un et l’autre reste lui-même qu'il sera “bon”, chacun à
sa façon ! C'est la conviction de la racio-psychologie allemande que
j'ai l’honneur de représenter, et cette conviction, la politique raciale
allemande l’a reprise à son compte : le Bureau de la politique raciale
du NSDAP a ainsi fait imprimer et distribuer dans les écoles des
planches illustrées où l’on peut lire en gros caractères : « TOUTES LES
RACES SONT UNE VALEUR SUPRÊME »
La deuxième illusion que l’Osservatore Romano
voudrait propager est la suivante : pour la science allemande, une race
se distinguerait d'une autre par la possession de telles qualités,
telle autre race ayant telles autres qualités. La race nordique, par
exemple, se signalerait par son discernement, son dynamisme, son sens
des responsabilités, son caractère consciencieux, son héroïsme — les
autres races étant dépourvues de toutes ces qualités. Il n’est pas
niable que de nombreux traités d'anthropologie anciens, dont certains
furent rédigés par des Allemands, contiennent ce genre d'affirmations
bien peu psychologiques. Cela dit, ne vaut-il pas mieux consulter un
cordonnier pour ses chaussures, un marin sur la navigation et un
psychologue plutôt qu'un anatomiste sur les lois de la psychologie ?
Depuis
1921, la racio-psychologie allemande nous enseigne clairement ceci :
l’âme d'une race ne réside pas dans telle ou telle “qualité”. Les
qualités sont affaire individuelle : untel aura telles qualités, untel
telles autres. La qualité “héroïsme” se rencontre sans aucun doute chez
de nombreux Nordiques, mais également chez d'autres races. Il en est de
même du dynamisme, du discernement, etc. L’âme d'une race ne consiste
pas à posséder telle ou telle “qualité”, elle réside dans le mouvement à
travers lequel cette qualité se manifeste quand elle est présente chez
un individu. L’héroïsme d'un Nordique et d'un Méditerranéen peut être
“égal”, il n’en reste pas moins que ces deux héroïsmes ne se présentent
pas de la même façon : ils opèrent de manière différente, par des
mouvements différents.
Le
procédé parfaitement puéril consistant à rassembler une somme de
qualités relevées chez quelques représentants individuels d'une race
donnée, disons de la race nordique, et à (faire) croire que c'est dans
la possession de ces qualités que réside le fait racial, est à peu près
aussi intelligent que de vouloir décrire l’aspect physique de la race
nordique, par exemple, en disant : elle a un nez, une bouche, des bras,
des mains. Sans nul doute, cette race possède tout cela, et bien
d'autres choses encore. Mais toutes les races possèdent un nez, une
bouche, des bras et des mains. Ce n’est donc pas là, dans la possession
de telle ou telle partie du corps, qu'il faut chercher le fait racial.
Ce qui, en revanche, est déterminé racialement, c'est la forme du nez,
de la bouche, et la manière dont on s’en sert. Même chose pour la forme
des bras, des mains, et la façon dont ils se meuvent. Que l’homme de
race méditerranéenne évolue dans l’espace différemment du Nordique,
qu'il marche et danse différemment, qu'il accompagne son discours de
gestes différents, cela est indéniable, il suffit d'ouvrir les yeux.
Quant à savoir quels mouvements du corps, quelle gestuelle, ont le plus
de “valeur”, ceux du Méditerranéen ou ceux du Nordique, c'est là une
question vide de sens. La réponse est : tous les deux, chacun à sa
manière, chacun selon son style propre.
Les
mouvements du corps sont l’expression des mouvements de l’âme, comme en
témoignent le jeu des muscles de la face et les gestes des bras et des
mains qui ponctuent l’élocution. Pourquoi le locuteur agite-t-il ses
mains de telle façon et non pas autrement ? Parce que le rythme auquel
vit son âme lui dicte cette façon-là de remuer les mains. Le style des
mouvements de l’âme détermine le style des mouvements du corps, car tous
deux ne font qu'un.
Un
exemple simple, tiré de l’observation quotidienne, illustrera ce propos
: lequel, du Nordique ou du Méditerranéen, est le plus “doué” pour
conduire une automobile ? Question, ici encore, vide de sens : ce n’est
pas “le” Nordique, ni “le” Méditerranéen, qui a le don de ceci ou de
cela, de nombreux êtres humains, appartenant à ces deux races, sont
capables de conduire une automobile. Mais les Nordiques le seront d'une
certaine manière, et c'est cette manière qui les fera apparaître comme
tels. De même, les Méditerranéens le seront à la manière
méditerranéenne, et c'est à cela qu'on les reconnaît comme
méditerranéens. Voici la différence entre ces deux styles de conduite :
le conducteur méditerranéen est maître de l’instant : où qu'il se
trouve, il y est dans la perfection achevée du moment présent. D'un
mouvement brusque du volant, il abordera un virage à toute vitesse,
évitera un obstacle et freinera avec effet immédiat. Plus l’action est
folle, dangereuse, plus le jeu sera magnifique. L’automobiliste nordique
ne le suit pas sur ce terrain-là : non parce qu'il est piètre
conducteur, mais parce que la loi qui préside aux mouvements de son âme
et de son corps lui dicte un style de conduite différent. Le Nordique ne
vit pas dans ce qui est, il vit toujours dans ce qui viendra : il n’est
pas le maître de l’instant, il est le maître du lointain. Il n’abordera
pas un virage de façon brusquée, il décrira au contraire un vaste arc
de cercle : pour lui, le virage est “beau” s’il l’a prévu et s’il
l’accentue le moins possible. Le Méditerranéen affectionne la surprise,
l’imprévu : par là, il s’affirme comme le maître de l’instant présent.
Le Nordique, lui, essaie toujours de pressentir, de prévoir ce qui va
venir, même si cela n’est pas certain. C'est pourquoi il se crée un code
de la route pensé jusque dans ses ultimes éventualités — ce qui
exaspère le Méditerranéen. Car pour ce dernier, supprimer l’excitation
de la surprise, ce n’est pas lui simplifier la tâche !
La troisième erreur que commet l’Osservatore Romano
consiste à affirmer ceci : le peuple allemand se confond avec la race
nordique, le peuple italien avec la race méditerranéenne. Si ce n’est
pas dit explicitement, c'est admis implicitement. Or, le peuple allemand
est composé de plusieurs races, parmi lesquelles la nordique prédomine
bien sûr, mais elle n’est pas exclusive : il y a du sang méditerranéen
dans le peuple allemand.
D'ailleurs,
le peuple italien lui-même est constitué de plusieurs races, parmi
lesquelles la race méditerranéenne domine certes (du moins dans la
moitié Sud de la péninsule) ; mais il y a d'autres apports dans le
peuple italien, par ex. beaucoup de sang nordique. Il n’existe pas de
frontière raciale rigide entre les deux peuples, ils ont au contraire de
nombreux traits communs, y compris au niveau du sang. Cette parenté
biologique remonte très loin dans la Rome primitive et a, depuis, été
renouvelée par plusieurs apports. Au sein des deux cultures, la
germanique et la latine, les lois de la nordicité coexistent avec celles
de la latinité mais le résultat en est différent d'une culture à
l’autre : ces deux civilisations se sont formées ensemble, au contact
l’une de l’autre. La latine est plus ancienne, la germanique plus
récente. Laquelle a le plus de valeur, la plus ancienne ou la plus jeune
? Là encore, le problème nous paraît mal posé.
Le
piège qui consiste à faire porter le soupçon sur la politique raciale
allemande pour semer la méfiance entre peuples amis ne peut aujourd'hui
leurrer que les naïfs. Tous les actes de la politique internationale, ou
coloniale, viennent corroborer les acquis de la racio-psychologie et
confirment son utilité pratique dans les relations avec des peuples
différents. Son but n’est pas de séparer les peuples, mais de les
rapprocher en fondant entre les divers types humains une compréhension
mutuelle éclairée par la science.
► Ludwig Ferdinand Clauss, L’âme des races, Introduction, L’homme Libre, Paris, 2001.

 David et Goliath
David et Goliath
Il
y a quelque chose qui, lorsque nous étions jeunes adolescents,
provoquait chez nous une étrange impression : lors des cours d’histoire
sainte, nous ne parvenions pas toujours à voir les choses de la façon
dont le maître souhaitait qu’elles fussent vues en fonction des
instructions qu’il avait reçues. Ainsi, lorsque la Bible représentait
deux hommes aux prises en un combat singulier, notre sympathie n’allait
pas toujours vers celui à qui l’histoire biblique et le maître donnaient
le beau rôle. Tel était le cas, par exemple, lorsque nous lisions le
récit suivant :
***
«
Les Israélites mobilisèrent, puis ils se rangèrent en bataille contre
les Philistins. Ceux-ci se tenaient sur une hauteur, et Israël sur la
colline située en face d’eux, de sorte qu’une vallée les séparait. Du
camp des Philistins sortit un champion, Goliath, de Geth, dont la taille
était de six coudées plus une palme. Il portait sur la tête un casque
d’airain, sur le corps une cuirasse à écailles, qui pesait cinq mille
sicles d’airain, et portait entre les épaules un javelot d’airain. Le
bois de sa lance ressemblait à une ensouple de tisserand, et le fer en
pesait six cents sicles de fer. Un écuyer le précédait. Il se présenta
donc et, s’adressant aux troupes israélites : « Pourquoi, leur
cria-t-il, vous êtes-vous mis en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin
et vous les esclaves de Saül ? Choisissez-vous un homme qui descende
contre moi. S’il l’emporte en se battant avec moi et qu’il me tue, nous
serons vos sujets ; mais si je l’emporte et si je le tue, c’est vous qui
serez nos esclaves et qui nous servirez. Je jette aujourd’hui ce défi,
ajouta-t-il, à l’armée d’Israël. Donnez-moi un homme, que nous nous
battions ensemble ». Saül et tout Israël entendaient ces paroles du
Philistin, qui les mettaient dans l’effroi et la consternation.
Or,
David était un des huit fils de cet Éphratéen de Bethléem de Juda,
nommé Isaï, vieillard déjà au temps de Saül. Ses trois fils aînés
avaient suivi Saül à la guerre. (…) David était le cadet. Il allait et
venait du camp de Saül pour paître, à Bethléem, le troupeau de son père.
Cependant,
le Philistin venait se montrer matin et soir, se préparant au combat ;
et ce manège durait depuis quarante jours. Un jour, Isaï dit à son fils
David : « Prends pour tes frères un épha de grain rôti et ces dix pains,
et cours les porter à tes frères, au camp. Remets ces dix fromages à
leur chef de mille. Tu verras si tes frères vont bien et tu me
rapporteras un gage de leur part ». (…) Le lendemain matin, David,
laissant le troupeau à un berger, prit son paquet et partit, comme le
lui avait dit Isaï. Il parvint au camp, (…) déposa sa charge entre les
mains du gardien des bagages et courut aux lignes voir comment allaient
ses frères. Pendant qu’ils parlaient ensemble, voici que le champion
philistin, Goliath de Geth, s’avança hors des rangs de son armée, et
David l’entendit offrir le même défi (que les autres jours). Tout Israël
reculait à la vue de cet homme, tremblant de peur. « Voyez-vous,
disaient-ils, cet homme qui s’avance ? C’est pour insulter Israël. Celui
qui le tuera, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille,
et il exemptera d’impôts en Israël la maison de son père ». David
demanda alors aux hommes qui étaient à côté de lui : « Que donnera-t-on à
celui qui tuera ce Philistin et ôtera l’opprobre qui pèse sur Israël ?
Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter ainsi l’armée
du Dieu vivant ? ». On lui fit la réponse habituelle : « Voilà la
récompense qu’on donnera à celui qui l’aura tué ».
Le
frère aîné de David, qui l’entendait parler ainsi, se mit en colère : «
Pourquoi es-tu venu ici ? À qui as-tu laissé tes brebis dans le désert ?
Je connais ta prétention et ta rouerie ; c’est pour voir la bataille
que tu es venu ! ». « — Qu’ai-je encore fait ? repartit David. Ce
n’était qu’une simple question ! » Il s’éloigna alors de son frère et
interrogea d’autres hommes, dont il obtint la même réponse.
Or, ces paroles de David furent entendues, et elles furent rapportées à Saül, qui le fit venir près de lui. David lui dit :
« Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira se battre avec lui (…) Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et qu’un lion ou un ours enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et lui arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait contre moi, je le saisissais par sa crinière et je le tuais. Si ton serviteur a tué le lion et l’ours, le Philistin incirconcis aura bien le même sort, lui qui a insulté les armées du Dieu vivant. Et le Seigneur, ajouta-t-il qui m’a sauvé du lion et de l’ours, me tirera aussi des mains du Philistin ».
« Va, dit Saül à David, et que le Seigneur soit avec toi ! ».
Le
roi revêtit David de son armure, lui posa un casque d’airain sur la
tête et l’affubla d’une cuirasse. David ceignit l’épée de Saül
par-dessus son armure, et essaya de marcher dans cet appareil inusité.
Mais il dit aussitôt à Saül : « Je ne saurais marcher ainsi, je n’y suis
pas habitué ». Il s’en débarrassa, prit en main son bâton et choisit
dans le torrent cinq cailloux polis qu’il mit dans sa panetière. Puis,
tenant sa fronde à la main, il s’avança sur le Philistin. De son côté,
le Philistin, précédé de son écuyer, s’approcha de David. Il le regarda
(…) et n’eut que du mépris pour lui. Il lui dit : « Suis-je donc un
chien, pour que tu viennes à moi avec un bâton ? », et il le maudit en
invoquant ses dieux (1) (…) Mais David répondit : « Tu viens contre moi
avec une épée, une lance et un javelot ; et moi, je viens contre toi au
nom du Seigneur des armées, du Dieu des phalanges d’Israël, que tu as
insulté. Aujourd’hui, le Seigneur te livrera à moi (…) si bien que toute
la terre saura qu’Israël a un Dieu (…) ».
David
mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde :
il frappa le Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant
tomba face contre terre » (1, Samuel, 1- 49).
***
Telle
est l’histoire de la chute du “géant” Goliath. Bien entendu, on
attendait de nous, écoliers, qu’en notre for intérieur nous prenions
parti pour David qui, au moment où se déroule ce récit, avait déjà été
oint par le Seigneur, et que nous nous réjouissions, à l’instar des
armées d’Israël, de la chute du “géant”. C’était là justement toute la
leçon de cet épisode de l’histoire biblique. La plupart d’entre nous n’y
réfléchissaient guère, et glissaient sur la question. Pourtant, notre
prise de position intérieure n’était pas celle qu’on attendait de nous.
En dépit de notre bonne volonté, notre sympathie n’allait pas vers
David. Et même aujourd’hui, bien longtemps après, lorsque je me remémore
cette histoire, je me sens mal à l’aise ; et je sais qu’il en va de
même pour beaucoup d’autres. Ce sentiment qui subsiste en nous indique
clairement que, pour nous du moins, il y a dans cette histoire quelque
chose qui n’est pas net. À quoi cela peut-il tenir ?
Le
sujet du récit est un combat singulier opposant deux armées, comme on
en connaît beaucoup dans l’histoire ancienne des peuples indo-européens.
Tout comme le puissant guerrier Goliath, les héros d’Homère se
provoquaient en combat singulier. De même, dans le plus ancien poème
épique allemand, Le Chant de Hildebrand (Hildebrandslied) [vers 830] [extrait],
les deux héros goths, Hildebrand et Hadubrand, se lancent, au nom de
leurs armées respectives, un défi consistant à s’affronter homme à
homme, les armes à la main. Cette passe d’armes était souvent précédée
d’une joute verbale, dans laquelle les deux adversaires faisaient
l’éloge de leur race et de leurs propres exploits. Les adversaires se
“jaugeaient” : tel était le sens de cet affrontement. Mais encore
fallait-il, pour se “mesurer” de la sorte, que la mesure fut la même de
part et d’autre. Seuls s’affrontent en effet ceux qui se ressemblent ou
qui estiment se ressembler. Les armes qu’ils utilisent doivent être
identiques, ou similaires, et il en va de même de la façon de les manier
: le combat, surtout le duel, était régi par des règles très strictes
auxquelles les deux adversaires se soumettaient. La violation de ces
règles du combat était un forfait, bien pire qu’une défaite, puisqu’il
entachait l’honneur de celui qui avait failli. Tomber dans l’honneur
n’était pas pour effrayer des combattants d’une telle espèce ; pour
chacun d’eux, l’heure vient un jour de périr ! Par contre, si le
guerrier tombait en héros,
la gloire de ses exploits lui survivait : le héros périssait, l’honneur
demeurait vivant. Aussi le combat à la loyale, fixé par la règle et par
l’usage, représentait-il une réelle valeur chez les Indo-Européens, une
valeur d’ailleurs considérable, puisque selon le style
caractéristique de ces hommes, il pouvait en résulter une véritable
apogée, enjeu qui lui valait bien qu’on lui sacrifiât la vie de son
corps. Mais il importait que fût sauvegardée “l’honnêteté” des usages du
combat. Enfreindre ces usages équivalait à perdre son honneur ; dès
lors, la victoire n’était plus une victoire, mais quelque chose de pire
que la mort.
Or
quels sont les usages qui ont prévalu lors du combat singulier opposant
le jeune berger, dont le poids n’était pas bien considérable, au
guerrier philistin lourdement cuirassé ? Le “géant” se croit permis de
mépriser le petit pâtre parce que celui-ci ne saurait, de toute
évidence, être mesuré à la même aune à laquelle il se mesure lui-même.
Cette aune, c’est celle qui apparaît comme normale à tous les guerriers
familiarisés avec l’usage. C’est la mesure pure et simple. D’ailleurs,
non seulement les Philistins, mais aussi les “phalanges de Iahvé”
reconnaissent cet usage. Si tel n’était pas le cas, pendant les quarante
jours où, matin et soir, le géant a défié les meilleurs ennemis en leur
proposant un combat singulier, il y a longtemps que l’un d’eux aurait
fait ce que devait faire David par la suite : abattre traîtreusement le
colosse philistin avec une fronde, c’est-à-dire en se tenant à distance,
en toute sécurité. Mais les guerriers d’Israël ne connaissent pas
d’autre façon de procéder que celle d’entrer en lice à armes égales.
C’est pourquoi ils commencent par s’indigner contre ce petit berger qui
vient d’arriver dans leur camp et qui ne connaît pas la guerre. Ses
propres frères le grondent. Celui qui n’est pas capable de porter les
mêmes armes que le fort, n’a pas le droit de se battre contre lui,
précisément parce que le combat implique la commune mesure. “Cela ne va pas”, pensent les guerriers de métier.
Mais
David, qui n’est pas accoutumé aux usages du combat, fait une
découverte que les guerriers, liés par les règles de la guerre qu’ils
ont apprises, n’ont pas été capables de faire — ce qui ne les empêche
d’ailleurs pas de l’approuver après coup. Cette découverte, on peut la
résumer par une formule : “Mais si, cela va quand même !” Et en effet
cela peut aller, mais à une condition : c’est que l’on enfreigne l’usage
en vigueur, c’est que la règle de la commune mesure ne soit plus
respectée, c’est que l’on rejette cette conscience de l’usage de la
guerre qui plonge ses racines dans l’histoire et la nature profonde des
hommes. Dans le cas présent, toute la question est donc de savoir si la
violation de l’usage par David va pouvoir se justifier devant la
conscience historique de ceux qui appartiennent à son peuple et à son
temps, c’est-à-dire devant la communauté d’Israël.
David
a dit que le Philistin aurait « outragé l’armée du Dieu vivant ». Cette
déclaration est rapportée avec netteté dans le récit. Le Philistin a
mis l’armée ennemie au défi de lui envoyer un adversaire à sa taille
pour l’affronter en combat singulier. Mais dans l’armée ennemie, il n’en
est aucun qui lui ressemble. Et c’est pourquoi, au lieu de lui envoyer
quelqu’un qui soit de taille à l’affronter, Saül et son peuple sont
frappés de peur et d’étonnement. Le Philistin, alors, se moque d’eux et
les nargue pendant quarante jours.
Mais
le sarcasme et le défi ne confèrent nullement le droit de violer les
coutumes “loyales” de la guerre. Ils font même partie des usages en
vigueur. Le fait, pour une armée, de se trouver bafouée ne l’autorise
pas à faire fi des usages sacrés de la guerre. Personne n’y songe
d’ailleurs, à commencer par les bafoués. Aussi David, pour justifier son
geste, a-t-il recours à une autre méthode. Il ne dit pas : le Philistin
nous a outragés, il a outragé notre armée. Il dit : le Philistin a outragé l’armée du Dieu vivant.
En d’autres termes, il transforme en blasphème ce qui n’était qu’un
sarcasme. Et là, il touche un point essentiel de la conscience
historique de son peuple, qui n’entend pas être un peuple comme les
autres, avec son armée en campagne, mais un peuple particulier,
distingué par l’élection de tous les autres peuples : le peuple de
Iahvé, le “Dieu vivant”. Israël et Iahvé sont une seule et même chose :
qui outrage le peuple, outrage en lui Iahvé. En tant qu’armée de Iahvé,
Israël ne peut pas permettre que Iahvé soit outragé. Par suite, les
sarcasmes du Philistin ne relèvent plus d’une tradition guerrière,
admissible et courante, mais constituent un véritable sacrilège dirigé
contre Iahvé. L’événement prend alors, de l’intérieur, une dimension et
une signification totalement différentes. Désormais, le droit à la
“commune mesure” peut être sans préavis retiré à l’adversaire. Ce n’est
plus à un combat singulier que se rend David, mais à une expédition
punitive au nom de Iahvé l’outragé. Iahvé a jugé le Philistin et l’a
livré aux mains de David. Ainsi, David n’agit plus comme un guerrier au
combat ; il remplit la fonction d’un bourreau.
Pour
notre propos, il importe peu de savoir si le héros de l’histoire fut
vraiment David ou s’il s’agissait d’un personnage différent (selon le
second livre de Samuel, 21, 19, ce n’est pas David qui tue Goliath, mais
Elchanan, fils de Jaaré Oreghim) (2). Il suffit qu’il s’agisse d’un
homme du même peuple. Par le truchement de David, c’est en effet
d’Israël qu’il s’agit, et uniquement de lui. De même, la question de
savoir si le récit de la mort de Goliath le Philistin doit être pris au
sens historique littéral ou s’il s’agit “seulement” d’une légende, n’a
qu’une importance secondaire — que ce récit reflète avec fidélité le
mode d’existence et de pensée des Hébreux à cette époque précoce de leur
histoire ou à une période plus tardive. La légende permet souvent,
mieux que l’histoire dont on peut vérifier les détails, de jeter un
regard pénétrant sur la nature d’un peuple et sur l’idée qu’il se fait
de lui-même. Loin d’être une fable ou un conte de fées elle traduit
l’histoire mise en termes poétiques et, par là, elle en dit plus long
que les faits eux-mêmes. Elle donne d’un peuple l’image que celui-ci
entend laisser, au regard de son propre jugement historique.
La
scène qui se termine par la chute du puissant Philistin est donc
“historique” au sens à la fois profond et étroit de ce terme. Un
“héros”, qui vit dans la conscience de sa propre force et qui, dans le
monde où il se trouve, ne s’appuie sur rien d’autre que sur la
conscience d’une force supérieure, cherche à affronter [texte manquant].
Il ne veut pas d’une victoire acquise à bon compte sur plus faible que
lui — ce serait trop aisé — mais d’une rencontre avec un adversaire qui
vaille la peine, pour un homme de sa trempe, d’être “éprouvé”. Or, dans
la secteur qui est le sien, il ne parvient pas à trouver un seul
adversaire à sa mesure. Pendant quarante jours, il manifeste donc
bruyamment, par des cris lancés à l’ennemi d’un versant à l’autre de la
vallée qui les sépare, son désir ardent de se battre. Et finalement
c’est un petit bonhomme qui s’avance vers lui, seulement muni d’un bâton
et d’une panetière. Un guerrier aussi expérimenté devrait, semble-t-il,
s’apercevoir de quelque chose. Un adversaire aussi inattendu ne peut
être qu’un déséquilibré ou un individu retors. Mais le “géant” ne
remarque rien. Il constate seulement que ses espoirs d’avoir un de ses
pairs devant lui sont déçus, et il maudit ce berger dont la seule
apparition est à ses yeux un outrage. Pour lui, le combat représente un
instant suprême, une occasion solennelle de sublimer sa propre force —
mais à la condition que l’adversaire soit capable de déployer autant de
moyens que lui. Au lieu de cela, que voit-il ? Un petit berger, avec un
bâton ! Et c’est alors, tandis que ce puissant guerrier s’abandonne à
des pensées de ce genre, qu’une pierre polie l’atteint en plein front.
La
façon dont le colosse raisonne en son for intérieur est étrangère à
David. Mais David — et c’est en cela que réside sa supériorité — peut au
moins connaître cette façon de penser d’après les apparences
extérieures, et en tenir compte. Le colosse philistin, lui, ne peut
s’imaginer que quelqu’un entrant ouvertement en lice contre lui puisse
aborder le combat avec une mentalité de bourreau. D’après sa façon de
penser, ce serait une lâche trahison. Sa pensée lui interdit d’envisager
une telle perfidie. En effet, il ne veut et ne peut connaître que des
hommes comme lui, dont la conduite est analogue à la sienne : c’est ce
qui fait sa grandeur (ou, si l’on voit les choses avec les yeux de
David, sa bêtise). David, pour sa part, n’a pas la moindre idée de ce
qu’est l’ardent et sanglant désir de ce guerrier, qui ne peut exister
sans déployer sa force et qui a sans cesse besoin de se mesurer à
quelque chose ou à quelqu’un, qu’il s’agisse d’un ennemi ou d’un bloc de
pierre à amonceler. Il n’a pas idée qu’un homme puisse prendre racine
en lui-même, dans la conscience absolue de sa propre force. S’il pouvait
en avoir l’idée, il n’y verrait d’ailleurs rien d’autre qu’un outrage
envers Dieu. Sa force réside toute entière dans la mission qui lui a été
confiée par un autre que lui, en l’occurrence par Iahvé.
À
ses yeux, le combat ne représente pas une valeur en soi, ni une tâche à
exécuter selon une loi propre qui en constitue le fondement. Peut-être
même le combat représente-t-il pour lui un mal en soi, qui n’acquiert de
valeur que de façon indirecte, en tant que combat mené pour le compte
de Iahvé. La référence aux luttes qui l’ont opposé à des lions qu’il
prétend avoir pris à la gorge et assommés avec son bâton, produit moins
d’effets sur nous que sur Saül. De même, les questions qu’il pose avec
insistance sur les récompenses (richesse, mariage brillant, exemption
d’impôts) offertes à celui qui tuera le Philistin, et l’attention avec
laquelle il écoute les réponses, renvoient simplement à ce que tout
psychologue sait pertinemment, à savoir qu’une action humaine obéit
toujours à plusieurs mobiles, dont en général un seul est ressenti
consciemment. Ici, cet unique mobile tient dans la mission que Iahvé, le
“Dieu vivant”, lui a confiée. La force de David réside dans sa
certitude que l’adversaire — qui n’est d’ailleurs désormais plus un
adversaire, mais un condamné — lui a été livré par Iahvé.
Mesuré à son propre système de valeurs, David n’est ni un lâche ni un
traître, mais un serviteur de Iahvé.
Si
David avait une claire idée de la mentalité de son adversaire,
peut-être trouverait-il encore un autre motif de ne pas satisfaire aux
règles de combat que celui-ci considère comme “loyales”. C’est, tout
simplement, que ces règles ne le concernent pas — qu’elles relèvent d’un
style mental qui n’est pas le sien, et dans lequel il ne saurait se
reconnaître. Les règles de la guerre sont en effet déterminées par leur
nature même. Elles ne sont véritablement valides et contraignantes que
pour ceux dont le caractère ressemble au caractère de ceux qui les ont
créées.
Un
art du combat tel que le pratique le “géant” philistin, en le
considérant comme le seul possible, ne peut s’élaborer que dans un
esprit pour lequel la conscience de la valeur est fondée sur le
sentiment de la force propre. Pour le Philistin et pour ses semblables,
cet art du combat est authentique, et par conséquent il s’impose
naturellement. Pour des hommes dotés d’une autre mentalité, au
contraire, il est foncièrement étranger. Si des individus ayant une
mentalité différente le reconnaissent comme également valide pour eux,
comme ayant une portée d’engagement générale, cela signifie seulement qu
’ils acceptent de se soumettre à une loi d’essence étrangère. Il faut
d’ailleurs rappeler ici que le peuple philistin, ou tout au moins sa
couche dirigeante, était d’origine étrangère au pays, en l’occurrence
indo-européenne.
C’est
ce qui explique la taille “gigantesque” de certains de ses chefs. Cette
haute taille est caractéristique des races nordiques et faliques (3),
dont on retrouve la trace chez tous les anciens peuples indo-européens.
Chez ces peuples, un combat entre “géants” est parfaitement conforme à
la personnalité qui s’exprime dans la forme corporelle et mentale.
L’idéal est celui qu’expriment, indirectement, les “Rolands” que l’on
peut voir encore aujourd’hui sur les places municipales des vieilles
villes d’Allemagne du Nord (4) : des hommes à l’âme et au corps roides
et altiers, se tenant bien droits et s’appuyant sur une solide épée !
Goliath le Philistin était un homme d’une telle nature. Le peu que l’on
sait de lui (et qui émane uniquement de ses ennemis) suffit à faire
comprendre sa personnalité. Son destin était par avance scellé dans son
âme et son corps — sa chute également.
L’homme
indo-européen, concevant le monde à son image, se donne le droit de
modeler ce monde en fonction de l’idée qu’il s’en fait. Il ne peut faire
autrement. C’est sa “nature”. Mais la nature des autres peuples est
différente. Elle a aussi ses lois. Et quand ces autres peuples se dotent
d’une loi qui n’est pas la leur, alors ils se trouvent entraînés à
l’écart des voies de leur destinée propre. Leur personnalité est
défigurée. Tout d’abord, ils ne s’en aperçoivent pas, mais un jour, à
l’occasion d’un événement ou d’une circonstance particulière, leur
nature profonde réapparaît à la surface. Dans le cas qui nous intéresse,
il est fort possible que les usages de la guerre caractéristiques des
Philistins aient été pendant un certain temps superficiellement reçus
par les Hébreux, qui les ont tenus pour valables alors même qu’ils ne
reflétaient pas leur personnalité spirituelle. En témoigne la façon dont
le jeune David est d’abord regardé comme un “intrus”, que l’on
critique.et dont on se moque. Un fait pourtant est certain : en
“démasquant” la coutume étrangère et en décidant de ne plus se référer
qu’à Iahvé, David a montré qu’il se référait à une loi d’une autre
nature, et que cette loi est sans commune mesure avec celle qui
inspirait les actes de son adversaire.
C’est
ici que s’éclaire, tragiquement, le sens du mot “géant”. Goliath n’est
un “géant” qu’aux seuls yeux des autres. Pour les siens, sa mesure n’est pas gigantesque. Elle est tout simplement la norme.
Mais cette norme et tout ce qui en découle ne peuvent, par leur essence
même, avoir force de loi pour d’autres que lui et les siens. Cela vaut
pour la loi du combat “noble” ou “loyal”. Ce qui, pour les “géants”
philistins, est noble et loyal ne saurait l’être également pour ceux qui
sont dotés d’une autre personnalité psychique et corporelle. Or, un
combat d’après une même loi n’est possible qu’entre adversaires de même
nature. C’est seulement là où les personnalités des combattants se
pénètrent et se conviennent aussi intimement que les rouages d’un même
engrenage, là où ces combattants peuvent sans phrases se comprendre
jusque dans leur for intérieur, que le combat peut être “loyal” et quel
affrontement peut se dérouler d’une façon générale vécue et ressentie
comme “noble”. Au contraire, dans un combat où s’affrontent des
mentalités et des valeurs différentes, chacun se met obligatoirement
dans son tort parce que, quoi qu’il fasse, il ne peut que violer la loi
de l’autre ou en faire un mauvais usage. Pour des spectateurs neutres,
un tel combat, entre adversaires au caractère dissemblable, ne peut
qu’apparaître laid et moralement anarchique — même et surtout si les
deux partenaires restent fidèles à leur loi.
Telle
est la raison pour laquelle le combat de David et Goliath est si
pénible. Une lutte entre des hommes aussi différents, se référant à des
lois et des valeurs si différentes, ne peut jamais être loyal, honnête,
chevaleresque. La stature du “géant” Goliath excède la mesure du monde
dans lequel il a pénétré afin de le soumettre. En tenant sa propre loi
pour la seule possible, Goliath agit avec vitalité et bon sens. Mais il
ne saurait imposer aux autres ses propres traits de caractère. Aucune
“domination” ne peut durablement transformer l’étranger en non-étranger.
Amener l’étranger à se doter d’une loi qui n’est pas la sienne, le
défier sur un terrain qui n’est pas le sien, cela revient seulement à
fausser les conditions d’une vie en commun et, finalement, se mettre en
état d’infériorité. Aux yeux de Goliath, un David obéissant avec
sincérité à sa loi propre, ne peut être qu’un paltoquet, un traître et
un lâche. Aux yeux de David, Goliath ne peut être qu’un gros butor, un
monstre blasphémateur, et tous les moyens permettant de s’en débarrasser
peuvent être utilisés.
Quant
à nous, aussi longtemps que nous resterons fidèles à nous-mêmes, c’est
la façon de combattre que pratique et que réclame Goliath qui nous
apparaîtra juste, c’est-à-dire équitable selon notre caractère — même si
aujourd’hui chacun de nous n’a pas le physique de Goliath ! Cette façon
de concevoir le combat est pour nous la chose la plus naturelle qui
soit, parce que le comportement qui en est la base, étant inscrit dans
notre personnalité psychique, exige qu’il en soit ainsi. Nous comprenons
sans autre forme d’explication une telle conduite, une telle manière de
se battre ; et ici comprendre signifie : faire venir à la claire
conscience tout ce qui vit en nous. En revanche, nous ne sommes pas
instinctivement familiarisés avec un comportement différent. Même si
l’on nous en inculque la valeur exemplaire, le comportement de David
nous demeure étranger. Nous pouvons certes le découvrir, et même
l’étudier. D’emblée, nous ne le comprendrons jamais.
► Ludwig Ferdinand Clauss, traduit par Jacques Richan, publié dans : Études et Recherches n°2 (nouvelle série), 1983.
Titre originel : « David und Goliath oder die Gestalt als Schicksal ». Texte paru dans la revue Rasse n°4, 1937, pp. 137–145, repris dans le volume : Semiten der Wüste unter sich : Miterlebnisse eines Rassenforschers, 1937.
Notes :
1. Le texte grec de la Bible ajoute ici : « David répondit : — Non, tu es pire qu’un chien » (Ndt).
2.
Il semble, d’après l’exégèse moderne, que le récit primitif du premier
livre de Samuel rapporterait la victoire de David sur un adversaire
anonyme, simplement désigné du nom de « Philistin ». Par la suite, on
aurait ajouté en 17, 4 et 23 la mention : « Il s’appelait Goliath, de
Geth » (ou Gat). Pour harmoniser les deux récits, le premier livre des
Chroniques (20,5) attribue à Elchanan (Elhanân) la mort de Lahmi, frère
de Goliath. Cependant la contradiction demeure. En I Sam 17, 54, il est
dit que « David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem
». Or, à cette date, Jérusalem, conquise plus tard par David,
n’appartenait pas encore à Israël (Ndt).
3.
Le terme ethnique “falique” (ou “phalien”) a été formé à partir du nom
d’une ancienne population germanique, dont on retrouve la trace dans la
dénomination de la Westphalie (Phalie de l’Ouest) et de l’Ostphalie
(Phalie de l’Est, plus rarement employée) (Ndt).
4.
Devenues le symbole juridique des libertés et de la juridiction
municipale en Allemagne du Nord et en Basse-Saxe, les statues de
“Roland”, témoins de la statuaire germanique pré-chrétienne,
représentaient à l’origine une divinité du droit, probablement Forseti,
fils de Balder. Une des plus célèbres est le “Roland géant” situé à
Brême, près de l’Hôtel de Ville. Luther, en son temps, parlait déjà des «
Rolands et des géants ». Pendant longtemps, les “Rolands” furent des
figures mobiles, pivotant rapidement sur elles-mêmes, qui servaient à
l’entraînement des chevaliers et des combattants des tournois. Le nom,
qui vient du latin rollans, “qui tourne, qui pivote”, a ensuite
été confondu avec le nom de “Roland” dont l’étymologie est différente.
Le “Roland” de Hambourg portait naguère la nom de “Michel de fer” (der eiserne Michel),
ce terme de “Michel”, souvent employé pour désigner les Allemands en
général représentant un adjectif vieux et moyen-haut allemand signifiant
“Grand”, qui était une des épithètes d’Odhinn-Wotan (Ndt).
♦ Aperçu bio-bibiographique
 Disparu voici quelques années, Ludwig Ferdinand Clauss a été, en même temps que l’un des théoriciens de la Révolution conservatrice et l’une des figures les plus éminentes du mouvement de la “pensée nordique” (nordische Gedanke)
en Allemagne à partir des années vingt, l’un des précurseurs de l’étude
des mentalités et de la caractérologie ethnique. Ses travaux sur l’âme
des races et la psychologie des peuples arabes, en particulier, restent,
à beaucoup d’égards, toujours d’actualité.
Disparu voici quelques années, Ludwig Ferdinand Clauss a été, en même temps que l’un des théoriciens de la Révolution conservatrice et l’une des figures les plus éminentes du mouvement de la “pensée nordique” (nordische Gedanke)
en Allemagne à partir des années vingt, l’un des précurseurs de l’étude
des mentalités et de la caractérologie ethnique. Ses travaux sur l’âme
des races et la psychologie des peuples arabes, en particulier, restent,
à beaucoup d’égards, toujours d’actualité.
Né
le 8 février 1892 à Ottenburg, dans le Pays de Bade, Clauss fait des
études de philosophie, de psychologie, d’orientalistique, puis de
philologie allemande et scandinave, aux universités de Kiel et de
Fribourg-en-Brisgau. Il est notamment l’élève du philosophe Edmund
Husserl (1859-1938), qui exerce sur lui une très grande influence. Très
vite, il se spécialise dans l’étude de la psychologie ethnique, qu’il
décide d’entreprendre sur le terrain. En 1923, il partage la vie des
paysans norvégiens. En 1926, il navigue dans les eaux scandinaves à bord
de différents bateaux. Enfin, de 1927 à 1931, il séjourne longuement au
Proche-Orient, notamment en Palestine et en Arabie Saoudite, et passe
plusieurs mois chez les Bédouins du désert de Jordanie.
Dès 1923, il jette les bases d’une véritable « anthropologie psychologique » dans la première version de Die nordische Seele
(Niemeyer, Halle a.S.), ouvrage qu’il remaniera en 1932 (J.F. Lehmanns,
München), et dont les intuitions majeures seront ensuite développées
dans Rasse und Seele (J.F. Lehmanns, 1926). Fremde Schönheit (Kampann, Heidelberg, 1928), Rasse und Charakter (Moritz Diesterweg, Frankfurt/M., 1936) et Die Seele des Andern (Bruno Grimm, Baden-Baden, 1958). Ces livres connaîtront une diffusion assez considérable. Die nordische Seele aura huit éditions successives, Rasse und Seele en aura dix-huit.
Hostile
à toute démarche anthropologique qui se bornerait à une approche
“zoologique” des groupes humains, L.F. Clauss propose une caractérologie
ethnique qui se donne explicitement pour objet, non l’exclusion ou la
péjoration des autres races, mais une meilleure compréhension entre les
différents groupes humains. À cette fin, il s’appuie, non seulement sur
les données de la bio-anthropologie, mais aussi sur la phénoménologie de
Husserl et la philosophie du langage de Wilhelm von Humboldt. Il
attache également une grande importance à l’étude de la gestuelle, des
mimiques et des expressions.
[Ci-contre : couverture de Die nordische Seele, Munich, 1937]
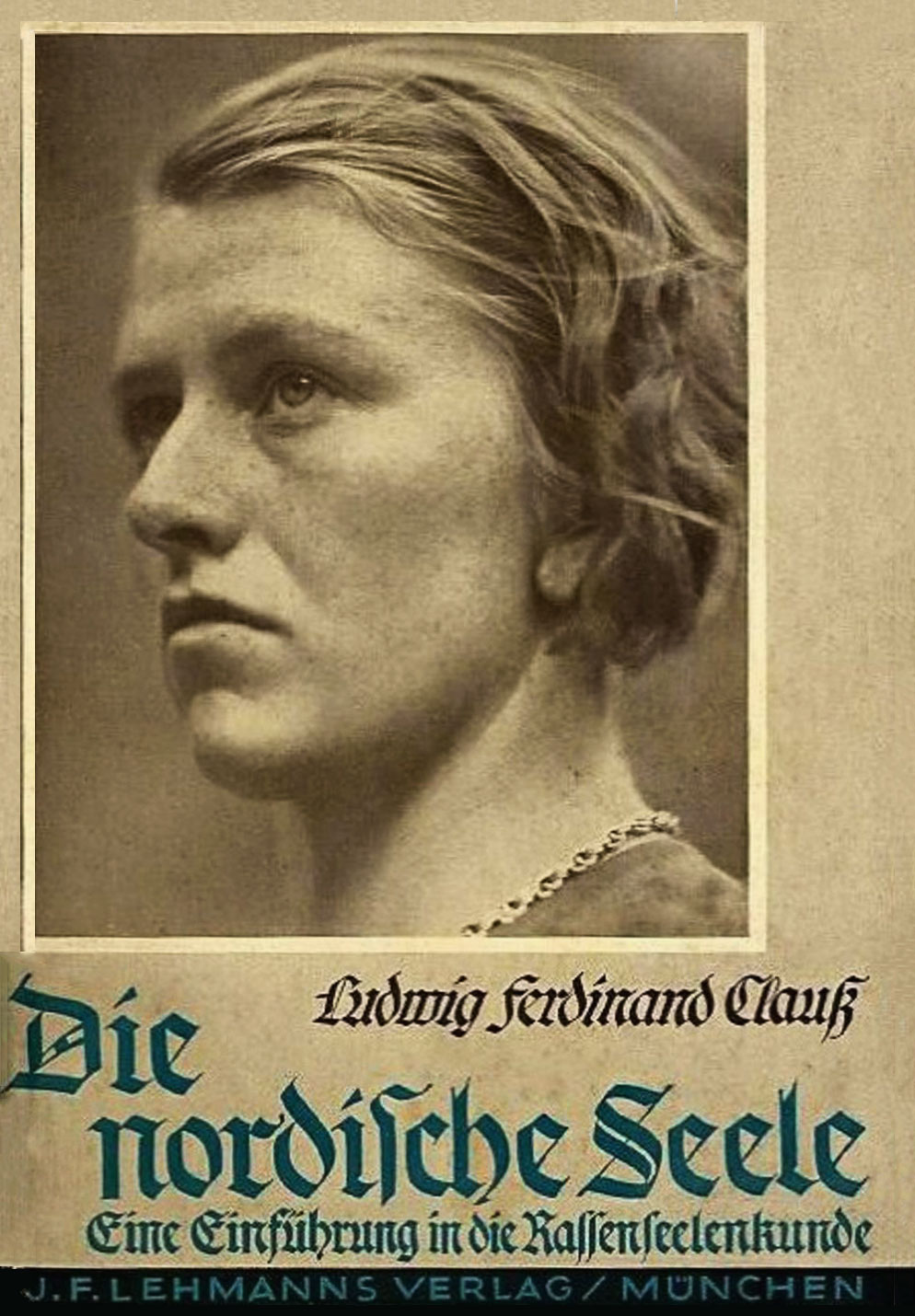 Clauss
constate que chaque peuple perçoit et “construit” le monde à
l’intérieur de sa conscience d’une manière qui lui est propre. Sorti du
laboratoire et resitué dans son cadre naturel de vie, tout homme est, à
des degrés divers, porteur du style caractéristique de l’âme du groupe ethnique auquel il appartient. Ce style se distingue fondamentalement des caractères
purement individuels. On peut établir une “morphologie” des différentes
manières dont le monde matériel se trouve “collectivement constitué”.
Chaque race est porteuse de son système de valeurs. Il n’existe pas de
paradigme commun ou supérieur à ces différentes échelles de références.
Toute comparaison qualitative entre les races se trouve par là privée de
sens. Toutes les races sont “supérieures”, en cela même qu’elles sont
incommensurables. « Jede Rasse hat ihren Höchstwert in sich selbst,
écrit Clauss, und kann nicht mit dem Massstab irgeneiner anderer
gemessen werden » (Chaque race possède en elle-même le critérium de ses
valeurs les plus hautes, et il n’existe pas de mesure commune qui puisse
permettre de la comparer à une autre). Ce qui distingue un paysan
scandinave d’un Bédouin jordanien, ce ne sont pas leurs qualités, mais
la ligne mélodique en fonction de laquelle ces qualités s’expriment.
Clauss
constate que chaque peuple perçoit et “construit” le monde à
l’intérieur de sa conscience d’une manière qui lui est propre. Sorti du
laboratoire et resitué dans son cadre naturel de vie, tout homme est, à
des degrés divers, porteur du style caractéristique de l’âme du groupe ethnique auquel il appartient. Ce style se distingue fondamentalement des caractères
purement individuels. On peut établir une “morphologie” des différentes
manières dont le monde matériel se trouve “collectivement constitué”.
Chaque race est porteuse de son système de valeurs. Il n’existe pas de
paradigme commun ou supérieur à ces différentes échelles de références.
Toute comparaison qualitative entre les races se trouve par là privée de
sens. Toutes les races sont “supérieures”, en cela même qu’elles sont
incommensurables. « Jede Rasse hat ihren Höchstwert in sich selbst,
écrit Clauss, und kann nicht mit dem Massstab irgeneiner anderer
gemessen werden » (Chaque race possède en elle-même le critérium de ses
valeurs les plus hautes, et il n’existe pas de mesure commune qui puisse
permettre de la comparer à une autre). Ce qui distingue un paysan
scandinave d’un Bédouin jordanien, ce ne sont pas leurs qualités, mais
la ligne mélodique en fonction de laquelle ces qualités s’expriment.
Au
lendemain de la venue au pouvoir de Hitler, ses travaux sur la
spiritualité nordique valent à Clauss une popularité certaine.
Toutefois, son refus obstiné de hiérarchiser les races, son insistance
sur la nécessité de pénétrer dans le système spirituel de chaque peuple
afin de mieux le comprendre de l’intérieur, lui valent bientôt les plus
sérieux déboires.
En 1936, chargé d’un cours de psychologie des peuples à l’université de Berlin, Clauss dans Rasse und Charakter,
critique nettement la théorie nationale-socialiste de la race. Quelques
mois plus tard, il démissionne de la direction de la revue Rasse,
dont il réprouve les orientations nouvelles. En 1940, le parti nazi,
ayant découvert que sa principale collaboratrice, qui habite chez lut et
dont il refuse de se séparer, est une juive nommée Margarete Landé,
multiplie contre lui les mises en garde et les critiques. Ses cours sont
surveillés par la police, et l’on tente, sans succès, de lui faire
abandonner ses travaux.
Le
28 mars 1941, au cours d’une session de travail organisée par.les
services de Rosenberg à la Haute École de Francfort-sur-le-Main, le Dr
Walter Gross, directeur du Rassenpolitisches Amt der NSDAP,
dévoile au grand jour la « non-conformité » des travaux de Clauss par
rapport aux orientations “raciales” de la NSDAP. Soulignant que Clauss
n’a jamais voulu adhérer au parti nazi et que, depuis bientôt vingt ans,
il travaille avec une collaboratrice « juive à 100% » (Volljüdin).
Il déclare : « Ce qui est important pour nous maintenant, c’est de
rejeter plus encore qu’auparavant Clauss et son œuvre dans l’ombre, de
mettre un terme à la polémique et tout simplement de la tuer par le
silence (totschweigen). On décidera en haut lieu sur la
question de savoir jusqu’à quel point ont peut le laisser poursuivre ses
travaux scientifiques… ».
La
réponse ne se fait pas attendre. Le 8 février 1942, les manifestations
destinées à célébrer le cinquantième anniversaire de Clauss sont
interdites ; la presse reçoit la consigne de ne pas faire état de
l’événement. Quelques mois plus tard, Clauss voit son enseignement à
l’université de Berlin frappé d’interdiction. En 1943, il est
officiellement démis de ses fonctions, et versé d’office dans la
Waffen-SS à titre disciplinaire. Son appartement est plusieurs fois
perquisitionné. Sa collaboratrice, Margarete Landé, est découverte dans
une propriété qu’il possède dans le Brandebourg. Elle est arrêtée et
incarcérée à la prison de Potsdam, d’où Clauss parvient à la faire
sortir. En 1945, ils fuient tous les deux vers l’Ouest, devant l’avance
russe.
 [Ci-contre : couverture de Die Seele des Anderen : Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenlande, B. Grimm Verlag, 1958]
[Ci-contre : couverture de Die Seele des Anderen : Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenlande, B. Grimm Verlag, 1958]
Après
la guerre, Clauss reprend immédiatement ses travaux. Il se consacre
plus spécialement aux pays arabes et passe à nouveau plusieurs années au
Proche-Orient, notamment en 1958-1960, 1962-1963 et 1965-1966. En
1966-1967, il séjourne aussi en Iran. De cette expérience “arabe” qui a
marqué toute sa carrière, Clauss a tiré la matière de plusieurs essais, Als Beduine unter Beduinen (Herder, Freiburg i. Br., 1931), Semiten der Wüste unter sich (Büchergilde Gutenberg, Berlin, 1937), Araber des Ostens (1943 ; 2ème éd.: 1949), Flucht in die Wüste (Herder, Freiburg i. Br., 1960), Die Weltsunde des Islams (1963), ainsi que trois romans : Thuraja (Kompass, Oberursel/Ts., 1950), Verhüllte Häupter (Berte lsmann, Gütersloh 1955) et Die Wüste macht frei (Bertelsmann, Güterloh, 1956). On lui doit également une traduction de l’Edda, Lieder der Edda (Lehmann & Schulze, Dresden, 1921), une autre de l’Antigone de Sophocle, Zwischen Gott und Statt (1948), ainsi qu’un drame intitulé König und Kerl (1948).
Ludwig Ferdinand Clauss est mort en 1974, à Huppert im Taunus, âgé de 82 ans.
► Robert de Herte (pseud. AdB), Études et Recherches n°2 (nouvelle série), 1983.