
Dans l’antre du Minotaure
par Georges FELTIN-TRACOL
En 2014, les éditions Le Cercle publient Le Minotaure planétaire. L‘ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial,
de Yanis Varoufakis, un professeur d’économie gréco-australien qui a
participé à la rédaction de la partie économique du programme de Georges
Papandréou, futur Premier ministre socialiste grec entre 2009 et 2011.
L’auteur ne sait pas encore qu’il rencontrera souvent ce Minotaure au
cours de ses 162 jours de ministre grec des Finances.
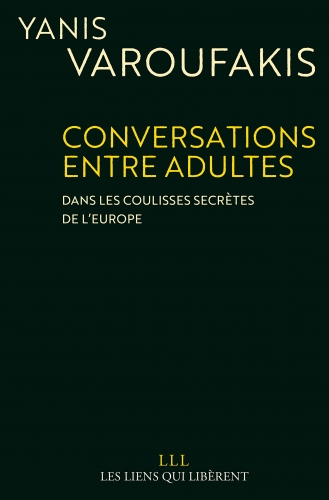 Yanis Varoufakis raconte dans Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe
cette brève expérience ministérielle et les négociations âpres avec
l’Eurogroupe, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds monétaire
international (FMI), la Commission européenne et ses homologues, en
particulier avec le plus puissant d’entre eux, l’Allemand Wolfgang
Schäuble, qui en découlent. Il offre ainsi un témoignage de première
main sur les mécanismes de ce qu’on croit être l’« eurocratie ». On
reste cependant confondu devant sa naïveté et son absence de sens
politique. L’« Homme de connaissance » se mue rarement en « Homme de
puissance »…
Yanis Varoufakis raconte dans Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe
cette brève expérience ministérielle et les négociations âpres avec
l’Eurogroupe, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds monétaire
international (FMI), la Commission européenne et ses homologues, en
particulier avec le plus puissant d’entre eux, l’Allemand Wolfgang
Schäuble, qui en découlent. Il offre ainsi un témoignage de première
main sur les mécanismes de ce qu’on croit être l’« eurocratie ». On
reste cependant confondu devant sa naïveté et son absence de sens
politique. L’« Homme de connaissance » se mue rarement en « Homme de
puissance »…
Extérieur à Syriza dont il désapprouve publiquement le projet économique et affligé par l’alliance scellée avec les souverainistes des Grecs indépendants,
Yanis Varoufakis se revendique libéral-démocrate, progressiste,
pro-européen et humaniste. C’est par amitié pour Alexis Tsipras et par
devoir envers ses compatriotes pressurés et appauvris qu’il accepte
cette mission impossible : renégocier la dette de la Grèce. Il croit
bénéficier de l’appui total du jeune et nouveau Premier ministre de
gauche radicale. Or, dès son entrée en fonction, il apprend que son
ministère dépend d’un ministère de l’Économie dont le titulaire n’est
autre que le vice-Premier ministre, très lié à certains milieux
bancaires. On lui impose ensuite un directeur de cabinet, véritable œil
du parti à ses côtés. Varoufakis reconnaît volontiers « avoir été
aveugle à une réalité aussi dure et déplaisante (p. 302) ».
En Grèce néo-colonisée
Son
livre est poignant quand il mentionne les souffrances endurées par
l’héroïque peuple grec. Celles-ci résultent des recommandations de la troïka
(la BCE, le FMI et la Commission européenne). Cette officine guère
respectable s’indigne de la diminution du traitement des
haut-fonctionnaires grecs qui la servent, mais exige la suppression
immédiate des aides financières aux plus défavorisés, la réduction du
montant des pension des retraités, la hausse des taxes et le paiement
immédiat des impôts par des entreprises exsangues. Les versements
consentis à la Grèce en font selon l’expression de l’auteur un «
Renflouistan » ! Il s’agit en réalité d’une « économie de la canonnière
».
Yanis
Varoufakis dénonce l’indéniable processus de colonisation 2.0 de son
pays par l’engeance financière cosmopolite. Par exemple, «
l’administration fiscale grecque est un des exemples les plus sidérants
de régime néocolonial des temps modernes (p. 172) ». En pratique, « le
directeur de l’administration [fiscale et douanière] devait désormais
être approuvé par la troïka et ne pouvait être renvoyé sans son
approbation (p. 57) ». Pis, « certains départements des
ministères-gruyères envoyaient d’abord leurs données et leurs documents à
la troïka, qui les approuvait, et seulement ensuite à leur ministre. Comme si ce n’était pas assez, la troïka
exigeait le droit d’envoyer des émissaires à Athènes, lesquels se
rendaient dans les mêmes ministères et rassemblaient des données qu’ils
triaient et vérifiaient avant que nous ne les ayons vues (pp. 307 – 308)
». Après juillet 2015, toutes les lois votées par la Vouli, le Parlement monocaméral, devront être en préalable approuvées par la troïka.
Certes,
« l’insuffisance du développement, la mauvaise gestion et la corruption
endémique de la Grèce expliquent sa fragilité économique permanente (p.
32) ». Il est possible d’y remédier alors que « son insolvabilité, plus
récente, est due aux défauts de fabrication fondamentaux de l’Union
européenne et de son union monétaire, autrement dit l’euro. À l’origine,
l’Union européenne était un cartel de grandes entreprises conçu pour
limiter la concurrence entre les principales industries lourdes d’Europe
et s’assurer des marchés dans les pays périphériques – l’Italie et,
plus tard, la Grèce. Les déficits de pays comme la Grèce étaient le
reflet des excédents de pays tels que l’Allemagne. Tant que la drachme
était sous-évaluée, les déficits étaient maîtrisés. Mais le jour où la
drachme a été remplacée par l’euro, les prêts des banques françaises et
allemandes ont envoyé les déficits grecs dans la stratosphère (p. 33) ».
Yanis Varoufakis explique qu’avec les difficultés hellènes, «
l’austérité révèle sa vraie nature : une politique économique de l’échec
fondée sur un moralisme immoral (p. 51) » parce que le renflouement de
la Grèce organisé sous la présidence de Sarközy « faisait reposer le
plus gros du sauvetage des banques françaises et allemandes sur les
contribuables de nations plus pauvres que la Grèce, par exemple la
Slovaquie et le Portugal. Ces contribuables-là, de même que ceux de pays
co-fondateurs du FMI comme le Brésil et l’Indonésie, seraient
contraints, à leur insu, de virer de l’argent aux banques de Paris et de
Francfort (pp. 36 – 37) ». Les médiats de propagande ont-ils répercuté
cette information ? Non, car, comme le dit le président aviné de la
Commission européenne, Jean-Claude Juncker : « Quand les choses
deviennent sérieuses, il faut mentir (p. 35). » Sinon la vérité aux
peuples contribuables serait insoutenable d’autant que « plus un
banquier est insolvable, surtout en Europe, plus il a de chances de
s’approprier des parts importantes des revenus de tous les autres – :
ceux qui triment, ceux qui innovent, les pauvres et, bien entendu, ceux
qui n’ont aucun pouvoir politique (p. 38) ». Les petites frappes de la
délinquance quotidienne devraient devenir des criminels de haut vol
intouchables, c’est-à-dire des banksters.
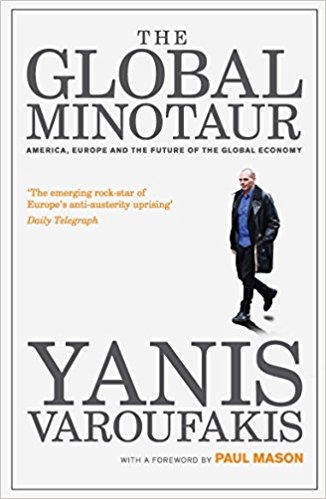 Ses
compétences économiques et son ignorance des codes de la
politique-spectacle font de Yanis Varoufakis une proie facile pour la
désinformation bankstériste. Contre lui, « la machine de
propagande de Bruxelles fonctionnait à plein régime (p. 287) ». Sachant
que les « banquiers ont simplement pris le relais et financé les médias
afin de manipuler l’opinion publique, donc de contrôler le jeu
politique, qui lui permettait de garder les commandes des banques en
faillite. Cela dit, contrairement aux promoteurs, ils ont été assez
astucieux pour éviter de devenir propriétaires de chaînes de télévision
et de journaux déficitaires. Ils ont maintenu en vie les médias en leur
offrant des clopinettes en échange de publicités pour leurs banques (p.
66) », il estime qu’« à l’heure où l’establishment dit libéral se récrie face aux fake news de l’alt-right en pleine insurrection, il est utile de se rappeler que, en 2015, ce même establishment
a lancé une campagne de retournement de la vérité et de diffamation
terriblement efficace contre le gouvernement pro-européen et
démocratiquement élu d’un petit pays européen (p. 10) ». La
revendication du credo libéral n’est pour lui qu’un prétexte.
Critique envers « les télé-évangélistes de l’asservissement (p. 164) »,
Varoufakis considère qu’« un establishment qui exploite sans
vergogne des contre-vérités pour annuler un mandat démocratique et
imposer des politiques dont ses propres fonctionnaires savent qu’elles
ne sont pas efficaces ne saurait être qualifié de “ libéral ” (p. 476)
». Tout sera mis en œuvre pour briser cet opposant farouche « aux prêts
en série insoutenables qui maquillent une faillite pour en faire un
problème d’illiquidité (p. 46) ».
Ses
compétences économiques et son ignorance des codes de la
politique-spectacle font de Yanis Varoufakis une proie facile pour la
désinformation bankstériste. Contre lui, « la machine de
propagande de Bruxelles fonctionnait à plein régime (p. 287) ». Sachant
que les « banquiers ont simplement pris le relais et financé les médias
afin de manipuler l’opinion publique, donc de contrôler le jeu
politique, qui lui permettait de garder les commandes des banques en
faillite. Cela dit, contrairement aux promoteurs, ils ont été assez
astucieux pour éviter de devenir propriétaires de chaînes de télévision
et de journaux déficitaires. Ils ont maintenu en vie les médias en leur
offrant des clopinettes en échange de publicités pour leurs banques (p.
66) », il estime qu’« à l’heure où l’establishment dit libéral se récrie face aux fake news de l’alt-right en pleine insurrection, il est utile de se rappeler que, en 2015, ce même establishment
a lancé une campagne de retournement de la vérité et de diffamation
terriblement efficace contre le gouvernement pro-européen et
démocratiquement élu d’un petit pays européen (p. 10) ». La
revendication du credo libéral n’est pour lui qu’un prétexte.
Critique envers « les télé-évangélistes de l’asservissement (p. 164) »,
Varoufakis considère qu’« un establishment qui exploite sans
vergogne des contre-vérités pour annuler un mandat démocratique et
imposer des politiques dont ses propres fonctionnaires savent qu’elles
ne sont pas efficaces ne saurait être qualifié de “ libéral ” (p. 476)
». Tout sera mis en œuvre pour briser cet opposant farouche « aux prêts
en série insoutenables qui maquillent une faillite pour en faire un
problème d’illiquidité (p. 46) ».
De féroces descriptions
Certains
portraits croqués dans ce livre sont féroces. L’auteur se surprend de
découvrir le socialiste Michel Sapin, ministre français des Finances,
tout ignorer de la langue anglaise, maîtriser plus qu’imparfaitement les
arcanes économiques et montrer une incroyable duplicité à son égard :
cordial en privé, cassant devant les journalistes et les officiels. « La
comédie de Michel Sapin était à l’image de ce qui ne fonctionne pas
dans la République française (p. 198). » Quelques instants plus tôt, le
même Sapin lui avait déclaré : « – Yanis, il faut que vous compreniez.
La France n’est plus ce qu’elle était (p. 198). » Que voulait dire le
vieux pote de « Flamby » ?
Au
fil de ses rencontres électriques avec le président de l’Eurogroupe, le
ministre néerlandais Jeroen Dijsselbloem, Varoufakis le trouve « encore
plus vil que d’habitude (p. 429) ». Son jugement cinglant embrasse les
socialistes français et les sociaux-démocrates allemands qui « n’ont
cessé de se contredire, entre promesses creuses et vaines paroles (p.
397) ». L’auteur éprouve en revanche un véritable respect pour Wolfgang
Schäuble. Ce partisan implicite du Grexit pense que « des
élections ne sauraient changer une politique économique (p. 241) ». À
quoi bon alors en organiser et ensuite tenter d’exporter ailleurs les «
démocraties » occidentales ? Schäuble jette un temps le masque et se
montre tel qu’il est : libéral et sécuritaire. Ancien du FMI et
collaborateur de Varoufakis, Glenn Kim présente dans un courriel la
personnalité de Schäuble qui « déteste au plus haut point les marchés.
Pense qu’ils sont contrôlés par les technocrates. […] C’est un
européiste ardent. Il croit au destin d’une Europe à l’allemande (pp.
216 – 217) ». L’auteur évoque un esclandre lors d’une réunion
ministérielle, le 16 avril 2015. Ce jour-là, Michel Sapin envoie paître
Schäuble qui envisageait accroître l’influence de la troïka au sein de l’Eurolande. En effet, « Wolfgang Schäuble rêvait de voir la troïka
dicter sa loi à Paris (p. 479) ». Ce n’est que partie remise. L’auteur
se montre en revanche assez bienveillant envers la directrice générale
du FMI, Christine Lagarde, et couvre d’éloges Emmanuel Macron.
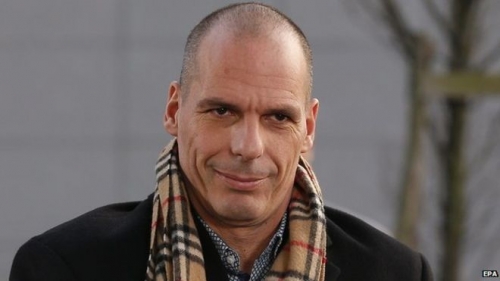
Yanis Varoufakis n’approuve pas le Grexit autant de la Zone euro que l’Union pseudo-européenne. Il cherche plutôt une « politique de désobéissance constructive
au sein de l’Union européenne. […] La seule alternative possible à la
dystopie qui se met en place à mesure que l’Europe se désintègre (p.
481) ». Il soumet donc à la troïka plusieurs plans, mais elle «
refusait systématiquement nos propositions sans en avancer une seule de
son côté (p. 348) », non seulement pour des motifs techniques ou
politiques, mais parce qu’il comprit bientôt que « ce que tous ces
hommes avaient en commun : c’étaient tous des transfuges de Goldman
Sachs (p. 244) ! » Cela expliquerait-il l’absence de vision politique
dans les instances européennes et leur neutralisation par des procédures
loufoques ? « La démocratie était morte le jour où l’Eurogroupe avait
obtenu le pouvoir de dicter leur politique économique à des États privés
de toute souveraineté fédérale démocratique (p. 241). » L’auteur
apprend ainsi qu’il ne peut pas distribuer le moindre document de
travail informel à ses homologues de l’Eurogroupe sous peine que ce
papier soit ensuite débattu au Bundestag. Et si Varoufakis
l’envoie en pièce jointe par courriel, il romperait le protocole et le
document en question ne serait pas pris en compte ! L’inertie comme
direction du désordre…
Yanis
Varoufakis déplore en particulier le juridisme tatillon et les pesants
rituels qui paralysent les séances de l’Eurogroupe et du conseil
européen des ministres. Il apprend vite que les fonctionnaires européens
lui mentent, le prennent de haut et ne lui communiquent jamais les
documents officiels. Il regrette que la rédaction du communiqué final de
l’assemblée soit plus importante que les choix adoptés (ou non). Il
s’étonne de règles qui contreviennent aux propres valeurs de la
démocratie délibérative. Le président de l’Eurogroupe introduit le
sujet; il donne ensuite la parole respectivement aux représentants de la
Commission européenne, du FMI et de la BCE; il laisse enfin s’exprimer
dans un temps imparti relativement court les ministres. « Un spectateur
impartial et sensé en conclurait que l’Eurogroupe n’est là que pour
permettre aux ministres de valider et légitimer les décisions prises en
amont par les trois institutions (p. 238). »
L’Eurogroupe existe-t-il vraiment ?
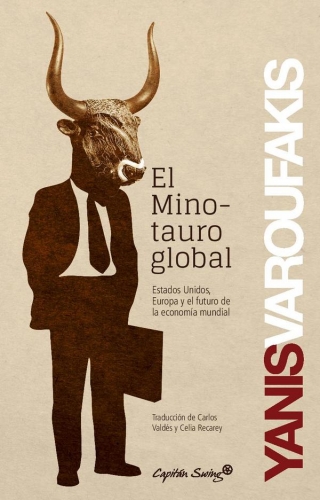 «
Les représentants de l’Europe officielle sont formatés pour exiger des
ministres, des Premiers ministres, même du président de la France,
qu’ils plient dès les premières menaces des gros bras de la BCE (p.
176). » La réalité est plus féroce encore. Jeroen Dijsselbloem ose
tancer Pierre Moscovici, le Commissaire aux Affaires économiques et
financières, ce qui « trahissait l’inféodation de la Commission à des
forces qui manquent de fondement légal ou de légitimité démocratique.
[…] Par la suite, chaque fois que [… Pierre Moscovici] ou Jean-Claude
Juncker essaieraient de nous aider, j’avais des frissons parce que je
savais que ceux qui détenaient le pouvoir nous taperaient dessus sans
pitié pour leur montrer l’exemple et remettre la Commission européenne à
sa place (p. 265) ». Exaspéré, Varoufakis balance à Christine Lagarde :
« Quand la BCE s’acoquine avec des banquiers corrompus et corrupteurs
qui sabotent sciemment la démocratie, ça s’appelle une action ennemie
(p. 362) ».
«
Les représentants de l’Europe officielle sont formatés pour exiger des
ministres, des Premiers ministres, même du président de la France,
qu’ils plient dès les premières menaces des gros bras de la BCE (p.
176). » La réalité est plus féroce encore. Jeroen Dijsselbloem ose
tancer Pierre Moscovici, le Commissaire aux Affaires économiques et
financières, ce qui « trahissait l’inféodation de la Commission à des
forces qui manquent de fondement légal ou de légitimité démocratique.
[…] Par la suite, chaque fois que [… Pierre Moscovici] ou Jean-Claude
Juncker essaieraient de nous aider, j’avais des frissons parce que je
savais que ceux qui détenaient le pouvoir nous taperaient dessus sans
pitié pour leur montrer l’exemple et remettre la Commission européenne à
sa place (p. 265) ». Exaspéré, Varoufakis balance à Christine Lagarde :
« Quand la BCE s’acoquine avec des banquiers corrompus et corrupteurs
qui sabotent sciemment la démocratie, ça s’appelle une action ennemie
(p. 362) ».
Les
souvenirs de l’auteur prouvent que ministricules et bureaucrates font
en sorte d’exclure et de nier tout cadre politique avec la ferme
intention de mettre sur le même niveau fonctionnaires de la troïka
et membres de gouvernement. « Les discussions techniques et les
discussions politiques doivent être fusionnées et organisées au même
endroit (p. 378) », affirme Pierre Moscovici. Le 27 juin 2015, suite à
sa demande, le secrétariat de l’Eurogroupe lui répond que « l’Eurogroupe
n’a pas d’existence légale, dans la mesure où il ne relève d’aucun des
traités de l’Union. C’est un groupe informel réunissant les ministres
des Finances des États membres de la la zone euro. Il n’existe donc pas
de règles écrites sur ses procédures que son président serait tenu de
respecter (p. 441) ». C’est exact, mais la reconnaissance de son
caractère informel invalide toutes les restrictions que Jeroen
Dijsselbloem a imposées à Yanis Varoufakis ! Oui, « l’Eurogroupe est une
drôle de créature. Les traités européens ne lui confèrent aucun statut
légal, mais c’est le corps constitué qui prend les décisions les plus
importantes pour l’Europe. La majorité des Européens, y compris les
politiques, ne savent pas exactement ce que c’est, ni comment il
fonctionne (p. 237). » L’auteur s’aperçoit que « le Groupe de travail
Eurogroupe (EWG) [est] sur le papier […] l’instance au sein de laquelle
se préparent les réunions de l’Eurogroupe; en réalité, ce groupe est une
sorte de sombre creuset dans lequel la troïka concocte ses
plans et ses politiques (p. 127) ». Relais direct d’Angela Merkel,
Thomas Wieser « était président du Groupe de travail Eurogroupe, cet
organe dont le rôle est de préparer les réunions de l’Eurogroupe, là où
les ministres des Finances de chaque pays prennent les décisions clés.
En théorie, donc, Wieser était le délégué de Jeroen Dijsselbloem,
ministre des Finances néerlandais et président de l’Eurogroupe. Ce que
je ne savais pas et que je mesurerais plus tard, c’est que c’était
l’homme le plus puissant de Bruxelles, beaucoup plus puissant que
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ou que
Pierre Moscovici, le commissaire aux Affaires économiques et financières
(le ministre des Finances de la Commission), voire, en certaines
occasions, plus puissant que Dijsselbloem lui-même (pp. 143 – 144) ».
Plus qu’une crise monétaire, financière ou économique, on devine que la
crise est avant tout politique du fait de l’occultation
volontaire et souhaitée du politique. Pourtant, « l’Europe peut donner
naissance à des institutions efficaces : la Banque européenne
d’investissement. La BEI appartient en effet aux États membres et elle
est gouvernée par les ministres des Finances européens (p. 268) ». Le
plus grave demeure le consentement béat de la plupart de minables
politiciens. Wolfgang Schäuble le reconnaît volontiers au cours d’un
échange privé avec Varoufakis : « Vous êtes le seul de l’Eurogroupe à
avoir compris que la zone euro est insoutenable. L’union monétaire a été
mal conçue. Nous avons besoin d’avoir une union politique, ça, ça ne
fait aucun doute (p. 402). » Schäuble applique cependant une politique
contraire parce qu’il écarte son européisme militant par rapport à de
puissants intérêts atlantistes et mondialistes qu’il représente.
Mieux
soutenu par son Premier ministre, Yanis Varoufakis serait peut-être
parvenu à négocier avec les usuriers rapaces de la Grèce, car les «
institutions », à savoir l’abjecte troïka, commençaient à se
diviser entre elles et en leur sein autour de l’acceptation ou non des
solutions réfléchies du gouvernement grec. Ce ne fut pas le cas. Dépité
par les manœuvres politiciennes tortueuses de Tsipras, prêt à renier ses
engagements de campagne afin de rester au pouvoir et d’en jouir
quotidiennement, et écœuré par le viol gouvernemental du référendum du 5
juillet 2015 (61,31 pour le « non »), l’auteur démissionne dès le
lendemain. La dissolution de la Vouli lui fera ensuite perdre
son mandat de député, ayant refusé de se représenter. Aujourd’hui, il
fait l’objet d’une accusation de « haute trahison » devant les
parlementaires. Un comble ! En devenant ministre, Varoufakis savait
qu’il servirait de fusible, mais pas si vite et pas comme bouc
émissaire.
Conversation entre adultes est un ouvrage essentiel pour mieux comprendre les rouages absurdes de la machinerie pseudo-européenne, bankstérisée
et effectivement proto-maffieuse qui massacre toute véritable idée
européenne. Le récit de Yanis Varoufakis est un avertissement pour tout
gouvernement qui tenterait de discuter avec les « institutions ».
Celles-ci ne connaissent qu’un seul langage : la force. Heureusement que
la France détient toujours de l’arme nucléaire…
Georges Feltin-Tracol
• Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Éditions Les liens qui libèrent, 2017, 526 p., 26 €.
