
L’auteur examine en quatre chapitres l’impact de celle-ci.
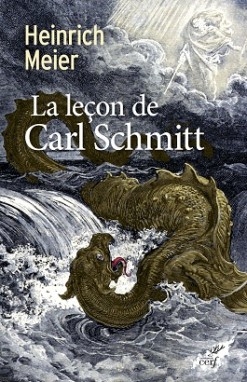 La leçon de Carl Schmitt
La leçon de Carl Schmitt
Chapitre 1: la réflexion schmittienne sur la morale
Dans le premier chapitre, centré sur la réflexion schmittienne sur la morale, l’auteur commence par montrer quel tableau –qui l’indigne– Schmitt dresse de son époque: un monde vivant aux pulsations de l’entreprise commerciale, rongé progressivement par la sécularisation et l’abandon de la foi, la démesure des hommes qui en «substituant à la providence les plans échafaudés par leur volonté et les calculs de leurs intérêts, pensent pouvoir créer de force un paradis terrestre dans lequel ils seraient dispensés d’avoir à décider entre le Bien et le Mal, et duquel l’épreuve décisive serait définitivement bannie.» (p15). La science elle-même n’est pour Schmitt que «l’auto-divination contre Dieu». Et Schmitt rejette ces formes d’auto-habilitation, par lesquelles l’homme prétend s’émanciper du Dieu transcendant.Or, ce que souligne l’auteur, c’est que c’est chez Bakounine que Schmitt trouve en quelque sorte le paradigme de cette rébellion et de cette défense de la désobéissance, contre le souverain et contre Dieu. Bakounine en effet «conteste l’objet de la conviction la plus intime de Schmitt. Il attaque la révélation et nie l’existence de Dieu; il veut supprimer l’Etat et nie l’universalité revendiquée par le catholicisme romain.» (p19) ( «Dieu étant tout, le monde réel et l’homme ne sont rien. Dieu étant la vérité, la justice, le bien, le beau, la puissance et la vie, l’homme est le mensonge, l’iniquité, le mal, la laideur, l’impuissance et la mort. Dieu étant le maître, l’homme est l’esclave. Incapable de trouver par lui-même la justice, la vérité et la vie éternelle, il ne peut y arriver qu’au moyen d’une révélation divine. Mais qui dit révélation, dit révélateur, messies, prophètes, prêtres et législateurs inspirés par Dieu même; et ceux-là une fois reconnus comme les représentants de la divinité sur terre, comme les saints instituteurs de l’humanité, élus par Dieu même pour la diriger dans la voie du salut, ils doivent nécessairement exercer un pouvoir absolu. Tous les hommes leur doivent une obéissance illimitée et passive, car contre la Raison Divine il n’y a point de raison humaine, et contre la Justice de Dieu, point de justice terrestre qui tienne. Esclaves de Dieu, les hommes doivent l’être aussi de l’Eglise et de l’Etat, en tant que ce dernier est consacré par l’Eglise.» Mikhaïl Bakounine, Dieu et l’Etat). La devise «Ni Dieu ni maître» affiche le rejet de toute forme d’obéissance et détruit les fondements classiques de l’obéissance dans la culture européenne d’après Schmitt. Pour Bakounine, la croyance en Dieu est la cause de l’autorité de l’Etat et de tout le mal politique qui en procède. D’ailleurs Schmitt reprend à Bakounine l’expression de «théologie politique» que ce dernier emploie contre Mazzini. Pour Bakounine, le mal vient des forces religieuses et politiques affirmant la nécessité de l’obéissance et de la soumission de l’homme; alors que pour Schmitt – et dans une certaine tradition chrétienne – le mal provient du refus de l’obéissance et de la revendication de l’autonomie humaine.
 Chez
ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un
même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui
représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour
Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa
sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce
combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus
important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens,
comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber
l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue
ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur
lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une
thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la
certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les
sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt;
seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les
pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale
sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du
Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge
en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle
s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à
défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette
résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique»
(p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance
et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social».
Chez
ces deux auteurs, politique et religion sont mises ensemble, dans un
même camp, dans une lutte opposant le bien au mal, même si ce qui
représente le bien chez l’un représente le mal chez l’autre. Pour
Schmitt, dans ce combat, le bourgeois est celui qui ne pense qu’à sa
sécurité et qui veut retarder le plus possible son engagement dans ce
combat entre bien et mal. Ce que le bourgeois considère comme le plus
important, c’est sa sécurité, sécurité physique, sécurité de ses biens,
comme de ses actions, «protection contre toute ce qui pourrait perturber
l’accumulation et la jouissance de ses possessions» (p22). Il relègue
ainsi dans la sphère privée la religion, et se centre ainsi sur
lui-même. Or contre cette illusoire sécurité, Schmitt, et c’est là une
thèse importante défendue par l’auteur, met au centre de l’existence la
certitude de la foi («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les
sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt;
seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les
pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale
sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du
Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge
en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle
s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à
défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette
résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique»
(p24).). Et c’est dans cette foi que s’origine l’exigence d’obéissance
et de décision morale. Schmitt croit aussi, comme il l’affirme dans sa Théologie politique, que «la négation du péché originel détruit tout ordre social».Chez Schmitt, derrière ce terme de «péché originel», il faut lire la nécessité pour l’homme d’avoir toujours à choisir son camp, de s’efforcer de distinguer le bien du mal («Seule une certitude qui réduit à néant toutes les sécurités humaines peut satisfaire le besoin de sécurité de Schmitt; seule la certitude d’un pouvoir qui surpasse radicalement tous les pouvoirs dont dispose l’homme peut garantir le centre de gravité morale sans lequel on ne peut mettre un terme à l’arbitraire: la certitude du Dieu qui exige l’obéissance, qui gouverne sans restriction et qui juge en accord avec son propre droit. (…) La source unique à laquelle s’alimentent l’indignation et la polémique de Schmitt est sa résolution à défendre le sérieux de la décision morale. Pour Schmitt, cette résolution est la conséquence et l’expression de sa théologie politique» (p24).). L’homme est sommé d’agir dans l’histoire en obéissant à la foi («la théologie politique place au centre cette vertu d’obéissance qui, selon le mot d’un de ses plus illustres représentants, «est dans la créature raisonnable la mère et la gardienne de toutes les vertus» (Augustin, Cité de Dieu XII, 14). Par leur ancrage dans l’obéissance absolue, les vertus morales reçoivent un caractère qui leur manquerait autrement.» (p31-32).), et il doit pour cela avant faire preuve de courage et d’humilité. L’auteur montre ainsi que loin de se réduire à la «politique pure», la pensée schmittienne investit la morale en en proposant un modèle aux contours relativement précis.
Chapitre 2: Réflexion sur la conception politique de Schmitt
Dans chapitre II, H. Meier montre que la conception politique de C. Schmitt ne peut être entièrement détachée d’une réflexion sur la vérité et la connaissance. En effet, Schmitt écrit, dans La notion de politique, que le politique «se trouve dans un comportement commandé par l’éventualité effective d’une guerre, dans le clair discernement de la situation propre qu’elle détermine et dans la tâche de distinguer correctement l’ami et l’ennemi». Cela implique que le politique désigne un comportement, une tâche et une connaissance, comme le met en évidence l’auteur. Pour mener à bien l’exigence d’obéissance mise au jour dans le chapitre précédent, il faut une certaine connaissance. Cela semble relativement clair, mais l’auteur va plus loin et défend la thèse selon laquelle non seulement le politique exige la connaissance, mais il veut montrer que l’appréhension du politique pour Schmitt est «essentiellement connaissance de soi» (p46).La distinction entre l’ami et l’ennemi s’appuie sur une notion existentielle de l’ennemi. L’ennemi présupposé par le concept de politique est une réalité publique et collective, et non un individu sur lequel on s’acharnerait, mu par une haine personnelle. Comme le précise H. Meier, «il n’est déterminé par aucune «abstraction normative» mais renvoie à une donnée de la «réalité existentielle» (…). Il est l’ennemi qui «doit être repoussé» dans le combat existentiel.» (p49). La figure de l’ennemi sert le critère du politique, mais chez Schmitt, selon l’auteur, elle n’est pas le fruit d’une élaboration théorique, voire idéologique, mais elle est ce en face de quoi je suis toujours amené existentiellement à prendre position et elle sert aussi à me déterminer et à me connaître moi-même, sur la base du postulat que c’est en connaissant son ennemi qu’on se connaît soi-même. Grâce à la distinction entre l’agonal et le politique, qui tous deux mettent en jeu la possibilité de ma mort et celle de l’adversaire ou de l’ennemi, mais qui s’opposent sur le sens de la guerre et la destination de l’homme ( Dans une compréhension politique du monde, l’homme ne peut réaliser pleinement sa destinée et sa vocation qu’en s’engageant entièrement et existentiellement pour l’avènement de la domination, de l’ordre et de la paix, tandis que dans la pensée agonale, ce qui compte, c’est moins le but pour lequel on combat que la façon de combattre et d’inscrire ainsi son existence dans le monde. E. Jünger, qui défend une pensée agonale écrit ainsi: «l’essentiel n’est pas ce pour quoi nous nous battons, c’est notre façon de nous battre. (…) L’esprit combattif, l’engagement de la personne, et quand ce serait pour l’idée la plus infime, pèse plus lourd que toute ratiocination sur le bien et le mal» (La guerre comme expérience intérieure).), Schmitt montre qu’il ne s’agit pas de se battre par principe et pour trouver un sens à vie, mais de lutter pour défendre une cause juste, ou mieux la Justice. Et c’est à ce titre que le politique est ce par quoi l’homme apprend à se connaître, à savoir ce qu’il veut être, ce qu’il est et ce qu’il doit être ( H. Meier développe ainsi un commentaire long et précis sur le sens d’une phrase de Theodor Däubler qui revient souvent chez Schmitt: «l’ennemi est la figure de notre propre question». Nous nous connaissons en connaissant notre ennemi et en même temps nous reconnaissons notre ennemi en celui qui nous met en question. L’ennemi, en quelque sorte, est aussi le garant de notre identité. Notre réponse à la question que l’ennemi nous pose est notre engagement existentiel-par un acte de décision – concret dans l’histoire.).
 La
confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A
ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique.
Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous
appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire
nous a assigné notre place historique et notre tâche
historique, et selon laquelle nous participons à une histoire
providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une
telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est
accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du
«propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique.
Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré
dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui
transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au
«propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est
lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous
montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma
confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et
ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre
propre forme.»« (p77-78).).
La
confrontation politique apparaît comme constitutive de notre identité. A
ce titre, elle ne peut pas être seulement spirituelle ou symbolique.
Cette confrontation politique trouve son origine dans la foi, qui nous
appelle à la décision («La foi selon laquelle le maître de l’histoire
nous a assigné notre place historique et notre tâche
historique, et selon laquelle nous participons à une histoire
providentielle que nos seules forces humaines ne peuvent pas sonder, une
telle foi confère à chacun en particulier un poids qui ne lui est
accordé dans aucun autre système: l’affirmation ou la réalisation du
«propre» est en elle-même élevée au rang d’une mission métaphysique.
Etant donné que le plus important est «toujours déjà accompli» et ancré
dans le «propre», nous nous insérons dans la totalité compréhensive qui
transcende le Je précisément dans la mesure où nous retournons au
«propre» et y persévérons. Nous nous souvenons de l’appel qui nous est
lancé lorsque nous nous souvenons de «notre propre question»; nous nous
montrons prêts à faire notre part lorsque nous engageons ma
confrontation avec «l’autre, l’étranger» sur «le même plan que nous» et
ce «pour conquérir notre propre mesure, notre propre limite, notre
propre forme.»« (p77-78).).Aussi les «grands sommets» de la politique sont atteints quand l’ennemi providentiel est reconnu. La politique n’atteint son intensité absolue que lorsqu’elle est combat pour la foi, et pas simple combat, guerre limitée et encadrée par le droit des gens moderne (Les croisades sont ainsi l’exemple pour C. Schmitt d’une hostilité particulièrement profonde, c’est-à-dire pour lui authentiquement politique.). C’est pour une communauté de foi, et plus particulièrement pour une communauté de croyants qui se réclame d’une vérité absolue et dernière, au-delà de la raison, que la politique peut être authentique. C’est d’abord pour défendre la foi qu’on tient pour vraie, une foi existentiellement partagée – et qui éventuellement pourrait être une foi non religieuse – que la politique authentique peut exister. C’est ainsi que Schmitt pense défendre la vraie foi catholique contre ces fausses fois qui la mettent en danger et qui sont le libéralisme et le marxisme. Ce qu’on appelle ordinairement ou quotidiennement la politique n’atteint pas l’intensité décisive des «grands sommets», mais n’en est que le reflet.
Chapitre 3: théologie politique, foi et révélation
Dans le troisième chapitre, H. Meier établit l’inextricable connexion entre théologie politique, foi et révélation. Aussi la théologie politique combat-elle l’incroyance comme son ennemi existentiel. Comme le résume l’auteur: «l’hostilité est posée avec la foi en la révélation. (…) la discrimination entre l’ami et l’ennemi trouverait dans la foi en la révélation non seulement sa justification théorique, mais encore son inévitabilité pratique» (p102). Obéir sérieusement à la foi exige, pour Schmitt, d’agir dans l’histoire, ce qui suppose de choisir son camp, c’est-à-dire de distinguer l’ami de l’ennemi. Politique et théologique ont en commun la distinction entre l’ami et l’ennemi; aussi, note l’auteur, «quand le politique est caractérisé grâce à la distinction ami-ennemi comme étant «le degré extrême d’union ou de désunion» (…), alors il n’y a plus d’obstacle au passage sans heurt du politique à la théologie de la révélation. La nécessité politique de distinguer entre l’ami et l’ennemi permet désormais de remonter jusqu’à la constellation ami-ennemi de la Chute, tandis que se révèle le caractère politique de la décision théologique essentielle entre l’obéissance et la désobéissance, entre l’attachement à Dieu et la perte de la foi.» (p104). L’histoire a à voir avec l’avènement du Salut, les fins politiques et théologiques sont indissociables pour Schmitt. La décision entre Dieu et Satan est aussi bien théologique que politique, et lorsque l’ennemi providentiel est identifié comme tel, le théologique et le politique coïncident dans leur définition de l’unique ennemi. Le reste du temps, politique et théologique peuvent ne pas coïncider, dans la mesure où toute confrontation politique ne met pas en jeu la foi en la révélation et où toute décision théologique ne débouche pas nécessairement sur un conflit politique. Et si Schmitt développe une théologie politique, c’est parce que ce qui est fondamental est le théologique (qui toujours requiert la décision et l’engagement de l’homme («la foi met fin à l’incertitude. Pour la foi, seule la source de la certitude, l’origine de la vérité est décisive. La révélation promet une protection si inébranlable contre l’arbitraire humain que, face à elle, l’ignorance semble être d’une importance secondaire.» (p138).)) qui prend parfois, mais pas toujours nécessairement, la forme du politique pour sommer l’homme de se décider.Puis l’auteur examine la critique de la conception de l’Etat dans la doctrine de Hobbes (dans Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbolisme politique) qu’il étudie en trois points.
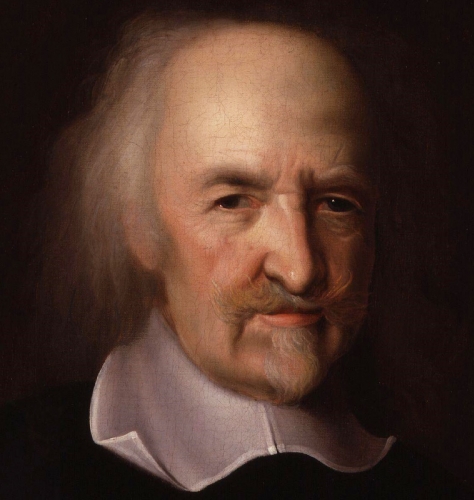 D’une
part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un
Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En
effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme
d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus
précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas
métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme,
l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même
nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus
prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes,
et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette
création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre
voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd
par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C.
Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté
déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme
le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et
communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir
créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).
D’une
part, Schmitt reproche à Hobbes d’artificialiser l’Etat, d’en faire un
Léviathan, un dieu mortel à partir de postulats individualistes. En
effet, ce qui donne la force au Léviathan de Hobbes, c’est une somme
d’individualités, ce n’est pas quelque chose de transcendant, ou plus
précisément, transcendant d’un point de vue juridique, mais pas
métaphysique. A cette critique, il faut ajouter que, créé par l’homme,
l’Etat n’a aucune caution divine: créateur et créature sont de même
nature, ce sont des hommes. Or ces hommes, véritables individus
prométhéens, font croire à l’illusion d’un nouveau dieu, né des hommes,
et mortels, dont l’engendrement provient du contrat social. Et cette
création à partir d’individus et non d’une communauté au sein d’un ordre
voulu par Dieu, comme c’était, selon Hobbes, le cas au moyen-âge, perd
par là-même sa légitimité aux yeux d’une théologie politique ( C.
Schmitt écrit ainsi que: «ce contrat ne s’applique pas à une communauté
déjà existante, créée par Dieu, à un ordre préexistant et naturel, comme
le veut la conception médiévale, mais que l’Etat, comme ordre et
communauté, est le résultat de l’intelligence humaine et de son pouvoir
créateur, et qu’il ne peut naître que par le contrat en général.»).D’autre part, Schmitt critique le geste par lequel l’Etat hobbesien est à lui-même sa propre fin. Autrement dit, cette œuvre que produisent les hommes par le contrat n’est plus au service d’une fin religieuse, d’une vérité révélée, mais, au contraire, est rendu habilité à définir quelles sont les croyances religieuses que doivent avoir les citoyens, qu’est-ce qui doit être considéré comme vrai. Enfin, Schmitt désapprouve le symbole choisi par Hobbes pour figurer l’Etat, le Léviathan.
Comme le note l’auteur, Schmitt pointe la faiblesse et la fragilité de la construction de Hobbes: «C’est un dieu qui promet aux hommes tranquillité, sécurité et ordre pour leur «existence physique ici-bas», mais qui ne sait pas atteindre leurs âmes et qui laisse insatisfaite leur aspiration la plus profonde; un homme dont l’âme artificielle repose sur une transcendance juridique et non métaphysique; un animal dont le pouvoir terrestre incomparable serait en mesure de tenir en lisière «les enfants de l’orgueil» par la peur, mais qui ne pourrait rien contre cette peur qui vient de l’au-delà et qui est inhérente à l’invisible.» (p167). Autrement dit, chez Hobbes, l’Etat peut se faire obéir par la peur de la mort, ce qui rend l’obéissance des hommes relatives à cette vie terrestre, alors que pour Schmitt, ce qui rend décisif et définitif l’engagement politique, c’est qu’il a à voir avec la fin dernière, le salut. Aussi peut-on être prêt ou décidé à mourir pour lutter contre l’ennemi, ce que nous craignons alors le plus est moins la mort violente que l’enfer post mortem. Et on comprend ainsi bien comment le libéralisme est ce qui veut éviter cet engagement, en niant la dimension proprement politique de l’existence humaine.
Chapitre 4: l'histoire comme lieu de discernement
Dans le dernier chapitre, centré sur l’histoire comme lieu de discernement dans lequel doit toujours se décider l’homme, l’auteur montre comment morale, politique et révélation sont liées à l’histoire pour permettre une orientation concrète («Pour la théologie politique, l’histoire est le lieu de la mise à l’épreuve du jugement. C’est dans l’histoire qu’il faut distinguer entre Dieu et Satan, l’ami et l’ennemi, le Christ et l’Antéchrist. C’est en elle que l’obéissance, le courage et l’espérance doivent faire leurs preuves. Mais c’est en elle aussi qu’est porté le jugement sur la théologie politique qui se conçoit elle-même à partir de l’obéissance comme action dans l’histoire.» (p177).). L’exemple privilégié par Schmitt pour mesurer un penseur qui se décide à l’histoire dans laquelle il se fait condamné à naviguer est celui de Hobbes. En effet, pour Schmitt, Hobbes prend position, avec piété pour l’Etat moderne, dans un cadre historique précis, celui des luttes confessionnelles, et sa décision en faveur de l’Etat qui neutralise les oppositions religieuses et sécularise la vie est liée à ce contexte historique. Si pour Schmitt, l’Etat n’est plus au XXème siècle une bonne réponse politique à la situation historique, au temps de Hobbes, se déterminer en faveur de cet Etat était la bonne réponse, puisque l’Etat «trancha effectivement à un moment historique donné la querelle au sujet du droit, de la vérité et de la finalité en établissant le «calme, la sécurité et l’ordre» quand rien ne semblait plus urgent que l’établissement du «calme, de la sécurité et de l’ordre»« (p183). En revanche, une fois conçu, l’Etat comme machine ou comme appareil à garantir la sécurité, il peut tomber entre les mains du libéralisme, du bolchévisme ou du nazisme qui peuvent s’en servir pour parvenir à leur fin, d’où sa critique de l’Etat au XXème siècle.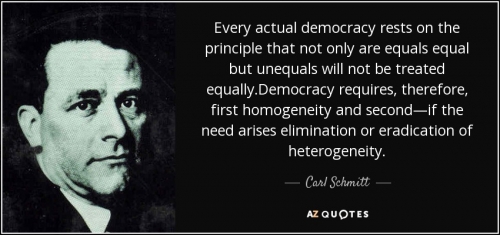
La question que pose alors l’auteur est celle de l’engagement de Schmitt. Il montre que Schmitt dans les années 1920 et au début des années 1930 commence par soutenir le fascisme mussolinien dans lequel il voit le modèle d’un Etat qui s’efforce de maintenir l’unité nationale et la dignité de l’Etat contre le pluralisme des intérêts économiques. Il oppose ce type d’Etat au libéralisme qu’il considère comme un «système ingénieux de méthodes visant à affaiblir l’Etat» et qui tend à dissoudre en son sein le proprement politique. Il critique l’Etat de droit bourgeois et en particulier le parlementarisme ( Il écrit ainsi dans l’article «l’Etat de droit bourgeois»: «les deux principes de l’Etat de droit bourgeois que sont la liberté de l’individu et la séparation des pouvoirs, sont l’un et l’autre apolitiques. Ils ne contiennent aucune forme d’Etat, mais des méthodes pour mettre en place des entraves à l’Etat.»). Il démasque l’imposture des prétendues démocraties qui n’intègrent pas le peuple, qui ne lui permettent pas d’agir en tant que peuple ( Pour Schmitt, le peuple ne peut être que réuni et homogène (c’est-à-dire non scindé en classes distinctes ou divisé culturellement, religieusement, socialement ou «racialement»). Il estime également que seule l’acclamation permet d’exprimer la volonté du peuple, à l’opposé des méthodes libérales qu’il accuse de falsifier la volonté du peuple.) mais l’atomisent, ne serait-ce que parce qu’au moment de la décision politique, les hommes sont isolés pour voter, alors qu’ils devraient être unis: «ils décident en tant qu’individus et en secret, ils ne décident pas en tant que peuple et publiquement.» (p204). Ce qui fait que les démocraties libérales sont pour lui des démocraties sans démos, sans peuple. Schmitt veut fonder la politique sur un mythe puissant et efficace, et dans cette optique, il estime que le mythe national sur lequel se fonde le fascisme est celui qui donne le plus d’intensité à la foi et au courage (plus, par exemple, que le mythe de la lutte des classes). Ce que souligne l’auteur cependant, c’est que pour Schmitt, tout mythe est à placer sur un plan inférieur à la vérité révélée. Il s’agit donc pour le théologien politique de ne pas croire ce mythe, national ou autre, parce qu’il est éloigné de la vraie foi, mais de l’utiliser pour intensifier la dimension politique de l’existence que tend à effacer le libéralisme européen de son époque.
Comment concilier la décision de Schmitt en faveur du nazisme au printemps 1933? Pour Heinrich Meier, il faut considérer avant tout que cet engagement est fait en tant que théologien politique et non en tant que nationaliste. Il faudrait la lire comme l’essai pour sortir de deux positions antagonistes et qu’il rejette toutes les deux: le libéralisme et le communisme, tous deux adversaires du catholicisme et animés par une commune tradition visant un objectif antipolitique (L’auteur écrit ainsi: «Pendant les dix années, de 1923 à 1933, durant lesquelles Schmitt, empli d’admiration, suivit le parcours de Mussolini, sa conviction que le libéralisme et le marxisme s’accordaient sur l’essentiel ou en ce qui concerne leur «métaphysique» ne fit que se renforcer: l’héritage libéral était toujours déterminant pour le marxisme, qui «n’était qu’une mise en pratique de la pensée libérale du XIXème siècle». La réunion du libéralisme et du marxisme dans la «nouvelle croyance» du temps présent (…) disposant d’un fonds de dogmes communs et poursuivant le même objectif final antipolitique, devait faire apparaître le fascisme et le national socialisme comme les antagonismes les plus résolus.» (p212-213).). A cela s’ajoute, selon l’auteur, l’idée que le nazisme s’appuie sur la croyance au destin et à l’importance d’agir dans l’histoire. Mais peu après cette explication des raisons de l’adhésion de Schmitt au national-socialisme, l’auteur s’attache à montrer que des critiques du régime apparaissent dans ses écrits. On peut ainsi selon l’auteur lire de nombreux passages du livre sur Hobbes comme des critiques indirectes du régime nazi qui ne pouvaient pas ne pas être prises comme telles à l’époque (par exemple, des passages dans lesquels il explique que si l’Etat ne protège pas efficacement les citoyens, le devoir d’obéissance disparaît, ou des passages exposant que si un régime relègue la foi à l’intériorité, le «contre-pouvoir du mutisme et du silence croît».) Cependant, l’auteur prend également soin de distinguer d’un côté l’éloignement de Schmitt du pouvoir nazi en place et de l’autre la persistance de son antisémitisme. Ainsi le livre sur Hobbes est foncièrement antisémite – l’antisémitisme de ce livre ne serait pas qu’un fond, un langage destiné à répondre aux critères de l’époque – comme, du reste, dans de nombreux ouvrages. Et pour l’auteur cet antisémitisme a son origine dans la tradition de l’antijudaïsme chrétien, ce qui n’a pas détaché Schmitt de l’antisémitisme nazi. Au contraire, comme le souligne H. Meier, «on est bien obligé de dire que c’est l’hostilité aux «juifs» qui lie le plus durablement Schmitt au national-socialisme (…) Et il restera fidèle, même après l’effondrement du Troisième Reich, à l’antisémitisme» (p220).
Puis l’auteur s’intéresse à l’interprétation que Schmitt fait de l’histoire en mettant au cœur de cette interprétation le katechon, qu’on trouve dans la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens, et qu’il définit comme «la représentation d’une force qui retarde la fin et qui réprime le mal» ( Schmitt écrit ainsi dans Terre et Mer: «Je crois au katéchon; il représente pour moi la seule possibilité, en tant que chrétien, de comprendre l’histoire et de lui trouver un sens.»). Schmitt expose une vision chrétienne de l’histoire (notamment exposée dans une critique de Meaning in History de Karl Löwith) qu’il entend opposer à celle du progrès défendue par les Lumières, le libéralisme et le marxisme. La Providence ne peut être assimilée aux planifications prométhéennes humaines. La notion de katechon permet d’une part de rendre compte du retard de la parousie – et donc de l’existence perse de l’histoire ( C’est d’ailleurs dans cette perspective que Paul en parle.); d’autre part, elle «protège l’action dans l’histoire contre le découragement et le désespoir face à un processus historique, en apparence tout-puissant, qui progresse vers la fin. Enfin, elle arme à l’inverse l’action dans l’histoire contre le mépris de la politique et de l’histoire en l’assurant de la victoire promise.» (p231-232). En effet, sans le katechon, on est conduit à penser que la fin de l’histoire est imminente et que l’histoire n’a qu’une valeur négligeable.
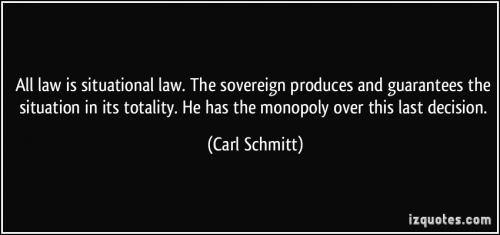
Ainsi, l’auteur parvient à montrer efficacement comment morale, politique, vérité révélée et histoire sont liées dans la pensée schmittienne, pensée ayant son centre dans la foi catholique de Schmitt. On ne peut comprendre la genèse des concepts schmittiens et leur portée véritable qu’en ayant à l’esprit cette foi expliquant sa pensée est moins une philosophie politique – si la philosophie doit être pensée comme indépendante de la foi en la révélation – qu’une théologie politique, pour ainsi dire totale en ce qu’elle informe tous les aspects de l’existence. La tentative d’H. Meier d’expliquer et de rendre compte et de l’engagement de Schmitt dans le nazisme –sans évidemment l’excuser ou n’en faire qu’une erreur malencontreuse– par l’antagonisme que ce régime pouvait manifester à l’encontre des autres régimes (libéralisme, marxisme) qui luttaient contre le catholicisme est pertinente, d’autant qu’elle ne le disculpe pas et qu’elle prend soin de souligner son indéfendable antisémitisme. Il faut aussi reconnaître à l’auteur une connaissance extrêmement précise des textes de Schmitt, de leur contexte et des adversaires que vise ce dernier même lorsqu’ils ne sont pas nommés, ce qui contribue à la clarification de maintes argumentations de Schmitt parfois équivoques ou elliptiques.
Source
