
"Enracinement", par Manon Potvin
Politique des racines
par Georges FELTIN-TRACOL
 En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale,
un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le
succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la
journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite.
En 2014, dans le sillage de la « Manif pour Tous », Gaultier Bès se faisait connaître par Nos limites. Pour une écologie radicale,
un essai co-écrit avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam. Le
succès de cet ouvrage lui permit de lancer en compagnie de la
journaliste du groupe Le Figaro, Eugénie Bastié, et de Paul Piccarreta, la revue trimestrielle d’écologie intégrale d’expression chrétienne Limite.
Au deuxième trimestre 2017, Gaultier Bès a publié Radicalisons-nous !
qui use et parfois abuse des métaphores végétales. Il a néanmoins
averti que « la métaphore (“ transport ”, en grec) n’est pas un rapport
d’identité, mais d’analogie (p. 27) ». Le titre est déjà un savoureux
contre-pied à l’opinion médiatique ambiante qui pourchasse toute
manifestation de radicalité. Pour les plumitifs stipendiés, la
radicalité signifie l’extrémisme. « Tous ceux qui sortent des sentiers
battus, on les disqualifie en les traitant d’extrémistes (ou
d’« ultra », de “ khmers ”, d’« ayatollas », et bien sûr de “ radicaux ”
(p. 13). » Pour preuve, les terroristes islamistes. Or, « l’extrémisme
se pense toujours contre, en marge, aux extrémités, par rapport à un
centre dont elle cherche toujours à s’éloigner. La radicalité, au
contraire, se suffit à elle-même. Elle va au bout de sa propre logique
(p. 114) » parce qu’elle part de la racine du sujet et/ou du
diagnostic. Les militants radicaux ne sont surtout pas des dingues
extrémistes bien souvent manipulés par des officines discrètes… Tout le
contraire des « djihadistes [qui] sont de nulle part et de
partout. Leurs places fortes sont semblables en cela aux grandes places
financières, multiculturelles, cosmopolites même (p. 110) ». Les «
soldats du Califat universel » sont en réalité des triples déracinés du
point de vue de la géographie, de la culture et de l’histoire. L’auteur
aurait pu les qualifier d’« individus unidimensionnels » au sens
marcusien du terme.
Radicalité et enracinement
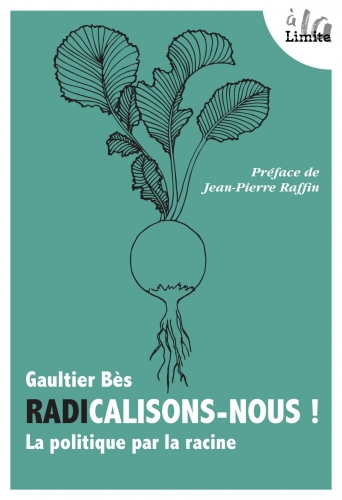 Dans
sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité «
est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre
être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social
qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ».
Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement,
la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en
extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un
racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ».
Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur
l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre
essai sur l’Enracinement.
Dans
sa préface, Jean-Pierre Raffin estime quant à lui que la radicalité «
est une notion noble qui fait appel aux fondements, aux racines de notre
être, de notre vie en société puisque l’être humain est un être social
qui, dépourvu de liens, disparaît ou sombre dans la démence (p. 7) ».
Gaultier Bès prévient aussi que « sans la profondeur de l’enracinement,
la radicalité se condamne à n’agir qu’en surface et se dégrade en
extrémisme. Sans la vigueur de la radicalité, l’enracinement n’est qu’un
racornissement, qui, faute de lumière, conduit à l’atrophie (p. 16) ».
Il se réfère beaucoup à la philosophe Simone Weil malgré une erreur sur
l’année de son décès, 1943 et non 1944, en particulier à son célèbre
essai sur l’Enracinement.
Il existe une évidente complémentarité entre radicalité et enracinement.
Il entend « réhabiliter la notion de radicalité et montrer qu’elle
n’est viable qu’à condition d’être enracinée (p. 12) ». Il insiste
volontiers sur le fait que « l’enracinement […] n’est pas nostalgique,
mais politique. Il ne rêve à aucune restauration, il ne fantasme aucun
âge d’or, il se pense plutôt comme une force révolutionnaire, une quête
de justice qui s’appuie sur une tradition non-violente. […] Ce n’est ni
une réaction ni un figement, mais un mouvement spirituel, une actualisation
dynamique qui s’appuie sur le passé pour mieux embrasser l’avenir (pp.
19 – 20) ». Par conséquent, il désapprouve l’expression de « Français de
souche ». Il a raison. Il y a plus d’une décennie, un rédacteur de Terre et Peuple
privilégiait « l’expression “ Européen de racine ” à celle d’« Européen
de souche » couramment employé parmi nous, car la racine c’est vivant
alors que la souche est morte (1) ».

Gaultier Bès
S’appuyer sur les racines n’implique pas un quelconque fixisme. Outre la nécessité d’éviter deux tentations, « celle du statu quo (p. 15) » et « celle de la table rase, et elle est à la mode. Le Progrès rase gratis
! (p. 15) », Gaultier Bès conçoit l’identité « comme une continuité
permanente, c’est-à-dire comme une réalité à la fois durable et
mouvante, évolutive et constante (p. 63) ». L’identité est comme la vie
d’un homme : l’allure physique d’une même personne varie au fil de
l’âge. L’identité française de 2018 n’est pas celle de 1830 et encore
moins celle de 1580. Elle repose pourtant sur un socle ethnique
indubitable d’origine boréenne. Gaultier Bès n’évoque pas ce patrimoine
génétique et anthropologique commun. Pour lui, « les peuples ont des
racines qui les rattachent et à un territoire et à une histoire, et que
les nations qu’ils forment au gré des circonstances sont moins des
radeaux de fortune que des “ maisons communes ” (p. 75) ». L’expression «
maison commune » serait-il un clin d’œil (incongru ?) au mouvement
métapolitique naguère animé par Laurent Ozon ? Gaultier Bès
connaîtrait-il par ailleurs les travaux de l’excellent revue Le recours aux forêts
qu’Ozon dirigea dans les années 1990 ? Cette belle revue défendait déjà
l’enracinement et l’écologie réelle, étudiait Jacques Ellul et Bernard
Charbonneau et se doutait que « l’enracinement sans radicalité est
artificiel, la radicalité sans enracinement superficielle (p. 80) ».
Identité(s) et politique
Gaultier
Bès se montre parfois sinon ambigu, pour le moins confus. Il considère
que « l’identité comme le chemin le plus sûr vers l’altérité (p. 52) ».
Très bien ! Mais comment concilier cette indispensable altérité quand il
écrit par ailleurs que la France est une vieille nation politique, un
État-nation qui s’est édifié sur un déracinement concerté des peuples,
des territoires et des métiers, sur l’ethnocide des campagnes et la
suppression des corporations ? Certes, « l’État-Nation n’est pas l’alpha
et l’oméga de la vie politique, reconnaît-il. C’est moins, à l’instar
de la laïcité, une “ valeur ” qu’un principe de gouvernement (p. 70) ».
Émanation de la Modernité, l’État-nation déracine tout, y compris ces
nations que sont les ethnies et les peuples. Mondialisme inassumé et
partiel, il arrase les différences essentielles. Il aurait pu introduire
dans sa réflexion la notion clé de terroir. Il semble
l’oublier. Or, sans terroir, l’enracinement se révèle impossible. Le
terroir est l’appropriation par le sang, l’égrégore communautaire,
l’histoire et la culture, le sol investi par les génies de lieu. La
nation dans sa fibre la plus authentique, avant de subir une évolution
stato-nationale, coïncidait à « une culture enracinée dans le terroir (bodenständig Kulture)
(2) ». Pourquoi dès lors vouloir opposer la nation à l’empire, cette
forme politique qui met en cohérence des nations culturelles plus ou
moins proches, dont il ne paraît pas saisir les implications pratiques
de ces diversités mises à l’unisson ? Le modèle impérial diverge de la
fallacieuse construction dite européenne. Il déplore les transferts de
souveraineté stato-nationale prévues par les traités européens vers une
strate européenne inexistante du fait de leur dépolitisation de ses
instances. Il en résulte leur neutralisation politique (Carl Schmitt).
L’Europe n’est pas le miroir du monde, mais la consécration d’un polyculturalisme enraciné et autochtone. « La polis ne saurait se superposer au cosmos
(p. 71) », et ce, malgré que « mondialisation culturelle et
globalisation économique sont les deux faces d’une seule et même
médaille (p. 76) ». Certes, « contre la City et son monde,
précise-t-il plus loin, être radical, c’est user pleinement de son droit
de cité (p. 123) ». Ce droit de cité ne présuppose-t-il pas
l’établissement de limites, appelées par exemple frontières
non seulement en géopolitique, mais aussi d’un point de vue juridique ?
Force est de constater que Gaultier Bès n’aborde pas ce sujet brûlant.
En effet, quelque soit sa nature, un État se doit d’établir des bornes tant territoriales que civiques. L’appartenance à une citoyenneté suppose une distinction radicale entre les citoyens et les autres, et justifie la préférence nationale. En bon Français, Gaultier Bès confond citoyenneté et nationalité.
« La nation est une fiction ? Sans doute ! Mais elle est une fiction
utile, condition d’une vie politique que soit autre chose que la chambre
d’enregistrement des grandes firmes mondialisées (p. 64). » La nation
comme peuple vivant n’est jamais fictive. C’est la citoyenneté qui
l’est, surtout à l’heure de ces saloperies de réseaux sociaux et de
matraquage télévisuel incessant, sans oublier les méfaits de la
partitocratie. Le temps est venu de dissocier la nation et l’État. La
première retrouve son caractère communautaire et identitaire; le second
prend enfin une tournure spécifiquement politique en devenant sciemment communautariste autochtone et en promouvant un aspect authentiquement plurinational.

L’auteur aurait pu se référer à l’excellente Note sur la suppression générale des partis politiques
de Simone Weil. L’État-nation meurt d’un leurre démocratique et de la
malfaisance des partis politiques. Outre la politicaillerie et
l’invasion de la Technique, la croyance en une illusoire « fin de
l’histoire (Francis Fukuyama) » favorise le pacifisme, abolit les
volontés et ricane du citoyen prêt à se sacrifier pour sa cité et les
siens. Le courage a déserté le Vieux Continent. Citoyenneté et res publica
demeurent pourtant des concepts hautement polémogènes. La cité n’existe
qu’à travers la perception, réelle ou supposée, d’un danger plus ou
moins imminent envers elle. Du coup, le paragraphe « La nation et la
paix » évacue le conflit comme permanence politique et nécessité
historique. La lecture d’un ouvrage méconnu de Régis Debray, Le code et le glaive (3), lui aurait été profitable dans une perspective « nationiste ».
Gaultier
Bès confond aussi le tribalisme, manifestation tangible de
l’hyper-modernité ultra-individualiste, du communautarisme, véritable
bête noire de la doxa ordo-républicaine hexagonale. Oublie-t-il
que l’Ancienne France d’avant 1789 était un agencement dynastique de
communautés multiples et variées ? On ne peut mettre dans une même
équivalence des démonstrations néo-tribales suscitées par le
consumérisme libéral (adeptes des rave parties, vegans, féministes hystériques, gays)
et l’affirmation salutaire de communautés spirituelles, ethniques,
culturelles et linguistiques. Les droits à la différence charnelle et à
la reconnaissance institutionnelles ne concernent que les Alsaciens, les
Basques, les Bretons, les Catalans, les Corses, les Savoisiens, voire
les musulmans, et nullement les fumeurs de shit, les joueurs de boules ou les fans de piercing
! Seule la renaissance de communautés organiques enracinées
favoriserait un renouveau démocratique de proximité. L’auteur constate
que « la politique se meurt de n’être plus qu’une grande surface
où le citoyen-consommateur erre, éperdu, entre les rayons pleins de
promesses et de programmes affriolants (pp. 13 – 14) ». Bref, « il nous
faut repenser radicalement la politique. La remettre à sa place
(p. 15) ». Comment remédier à la dépréciation du politique ? Par
l’intermédiaire des AMAP, des SEL, des coopératives, des jardins
partagés, du recyclage généralisé, des monnaies locales ? Toutes ces
excellentes initiatives n’influent cependant qu’en marge de la « société
liquide (Zygmunt Bauman) ». Le tissage des liens sociaux participe au
réenracinement et au maintient de son identité, de sa liberté et de sa
souveraineté. « Plus un peuple a des racines solides, plus il a de
ressources pour préserver son indépendance (p. 68). » Que faire alors
quand les racines s’étiolent et se sclérosent ? C’est le cas pour des
Français de plus en plus hors-sol.
Affranchissement du local
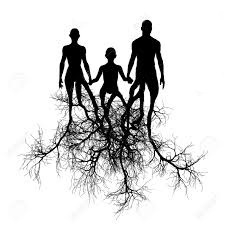 Gaultier
Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer «
l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ”
(p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme
procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines.
Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est
toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que
l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que «
le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local
hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du
Comité invisible, À nos amis. Le local « est une
contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le
local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas
la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel
: avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement
mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le
local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce
qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche,
Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. «
L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme
base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut
se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui
tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement
enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon
une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement
aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une
superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens,
normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »
Gaultier
Bès fait finalement trop confiance aux racines. Il a beau distinguer «
l’image végétale des “ racines [à] celle, toute minérale, des “ sources ”
(p. 25) », il se méprend puisque l’essence bioculturelle de l’homme
procède à la fois aux racines, aux sources et aux origines.
Ces dernières sont les grandes oubliées de son propos. Ce n’est
toutefois qu’en prenant acte de cette tridimensionnalité que
l’enracinement sera complet. Pourtant, il prend soin de préciser que «
le global n’est pas l’universel, c’est l’extension d’un local
hégémonique (p. 76) ». L’avertissement fait penser à l’opuscule du
Comité invisible, À nos amis. Le local « est une
contraction du global (4) ». « Il y a tout à perdre à revendiquer le
local contre le global, estime le Comité invisible. Le local n’est pas
la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel
: avant que le ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement
mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”. Le
local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce
qui peut le faire éclater (5). » Outre le collectif d’ultra-gauche,
Guillaume Faye s’interrogeait sur l’ambivalence du concept. «
L’enracinement doit […] se vivre comme point de départ, la patrie comme
base pour l’action extérieure et non comme “ logés ” à aménager. Il faut
se garder de vivre l’enracinement sous sa forme “ domestique ”, qui
tend aujourd’hui à prévaloir : chaque peuple “ chez soi ” pacifiquement
enfermé dans ses frontières; tous folkloriquement “ enracinés ” selon
une ordonnance universelle. Ce type d’enracinement convient parfaitement
aux idéologues mondialistes. Il autorise la construction d’une
superstructure planétaire où s’intégreraient, privés de leur sens,
normés selon le même modèle, les nouveaux “ enracinés ” (6). »
En lisant Radicalisons-nous !,
on a l’impression que l’enracinement des peuples du monde entier
assurerait une paix universelle, ce qui est à la fois irréaliste et fort
naïf. En effet, l’auteur écarte les facteurs d’imprévisibilité de
l’histoire. Même si tout un chacun (re)trouverait un enracinement
approprié, tensions et contentieux plus ou moins virulents persisteront.
En
célébrant « la politique par la racine », sous-titre de ce bon essai
qui fait la part belle aux formules bien tournées : « Pour que notre
avenir soit fécond, notre présent se doit d’être profond (p. 54) » et
s’achève sur un manifeste en dix points parmi lesquels « la radicalité
ne croit pas au Progrès (p. 120) » et « la radicalité est la condition
de toute écologie (p. 121) », Gaultier Bès ignore peut-être que
l’intérêt pour les racines n’est pas nouveau. Aux élections européennes
de 1999, la liste CPNT (Chasse, pêche, nature et traditions) avait pour
sympathique slogan « De toute la force de nos racines ». Plus
anciennement, en 1977, le Club de l’Horloge publiait Les racines du futur,
un magistral travail de reconquête intellectuelle qui mentionne « le
triple enracinement ». Le constat de cet essai démontre un plus grand
pragmatisme que celui de Gaultier Bès. « De cet enracinement dans
l’espace et le temps pourra naître une communauté de destin. La
définition d’un projet collectif doit enrayer les effets pervers d’un
enracinement qui pourrait favoriser l’éclosion d’une multitude
d’égoïsmes locaux ou régionaux. […] La définition d’un destin commun,
qui est de la compétence souveraine de l’État, la conquête collective
d’une “ nouvelle frontière ” économique, sociale, scientifique voire
géographique (comme la construction européenne), pourra, seule, sublimer
les égoïsmes et les particularismes, dans le respect des différences et
des autonomies (7). »
La
récente exposition éditoriale (y compris médiatique) d’une quête des
racines lui (re)donne cependant une sympathique notoriété métapolitique.
Qu’elle soit fertile auprès des Albo-Européens !
Georges Feltin-Tracol
Notes
1 : Jean-Patrick Arteault, « Guerre culturelle et combat identitaire », Terre & Peuple la revue, n° 25, Équinoxe d’automne 2005, p. 18.
2 : Martin Heidegger, Lettres à sa femme Elfride. 1915 – 1970,
le Seuil, 2007, lettre du 8 juillet 1918, p. 109. En matière
d’enracinement et nonobstant une langue souvent hermétique et
déroutante, y compris pour les germanistes, la pensée de Heidegger
présente plus que jamais un atout considérable, surtout à l’heure où une
cohorte de sycophantes « universitaires » ose contester l’auteur des
prophétiques Cahiers noirs.
3 : Régis Debray, Le code et le glaive. Après l’Europe, la nation ?, Albin Michel – Fondation Marc-Bloch, 1999.
4 : Comité invisible, À nos amis, La fabrique éditions, 2016, p. 191.
5 : Idem, pp. 190 – 191.
6 : Guillaume Faye, Europe et modernité, Eurograf, 1985, pp. 53 – 54.
7 : Club de l’Horloge, Les racines du futur. Demain la France, Masson, 1977, p. 194. Lisons aussi Bernard Charbonneau, L’Homme en son temps et en son lieu, préface de Jean Bernard-Maugiron, RN Édition, coll. « Ars longa, vita brevia », 2017.
• Gaultier Bès, Radicalisons-nous ! La politique par la racine, préface de Jean-Pierre Raffin, Éditions Première Partie, coll. « À la limite », 2017, 127 p., 7 €.