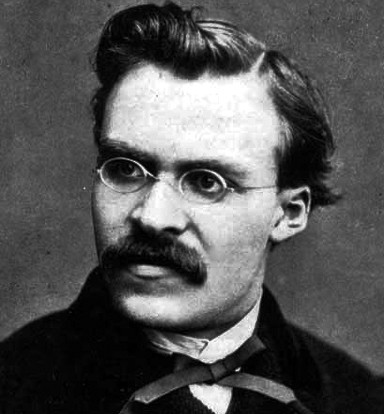
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
par Robert Steuckers
Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.
Une
promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre
du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les
innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter
Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo
Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.
Friedrich
Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des
Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann,
Würzburg, 1985.
Dans
ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école
nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au
départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la
puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et
destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un
langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage
nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique
et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde.
En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée
nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison
perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la
fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto
l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse
«volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et
affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler
cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique,
critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison
perspectiviste).
Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.
L'édition
allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à
pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz
qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la
dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et
ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois
principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus,
estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du
message francfortiste, doit se replonger dans l'humus
extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de
folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette
attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour
d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu
contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé
profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions
occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et
les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont,
elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette
revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend
superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le
droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions
des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi,
sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent,
occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories
objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».
Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.
On
sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la
vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le
précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé
dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui,
quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions
des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne,
désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West.
Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en
prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant
systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande
nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très
heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles
nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin,
on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses
interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions
géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo
étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations
positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck,
Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son
ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les
philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans
l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de
Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative
Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le
téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme
mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et
Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service
de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit,
que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le
surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme
d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du
Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se
pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon
de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné
(Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une
maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin
(Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de
malentendus...
Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.
Une
promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie
par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on
donnera d'emblée à ce petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le
chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des
modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il
n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une
philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le
geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le
créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance
que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé
car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la
plus osée, la plus haute.
