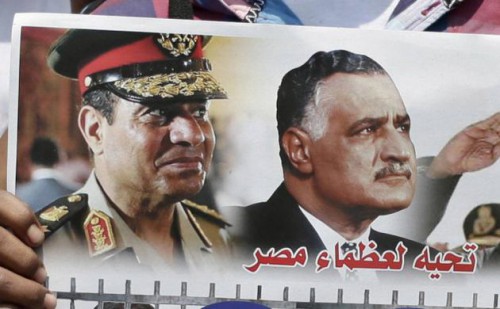
L'Occident perd son argumentaire
Michel Lhomme
Ex: http://metamag.fr
Le
commandement de l'armée égyptienne a donné lundi 27 janvier mandat à
son chef, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, pour se présenter à
l'élection présidentielle en Egypte. Le vice-premier ministre, homme
fort du pays depuis qu'il a destitué en juillet, par la force, le
président islamiste Mohamed Morsi, avait peu auparavant été élevé au
rang de maréchal, le plus haut grade de l'armée égyptienne, par le
président Adly Mansour.
Ce
dernier a confirmé que le scrutin présidentiel serait organisé avant
les législatives. Pour tous les observateurs, cette inversion judicieuse
du calendrier électoral devrait servir les intérêts du maréchal Abdel
Fattah Al-Sissi qui sera donc probablement élu.
 Mohamed
Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu
démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,
à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des
manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à
l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le
général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de
l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale
égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les
services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de
répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères
musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les
forces de l'ordre.
Mohamed
Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu
démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,
à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des
manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à
l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le
général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de
l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale
égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les
services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de
répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères
musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les
forces de l'ordre.
 Mohamed
Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu
démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,
à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des
manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à
l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le
général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de
l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale
égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les
services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de
répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères
musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les
forces de l'ordre.
Mohamed
Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu
démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,
à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des
manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à
l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le
général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de
l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale
égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les
services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de
répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères
musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les
forces de l'ordre.
Un pays gênant pour les Occidentaux
Pourtant,
dans les médias, l'Egypte est oublié. On tait, on camoufle l'Egypte. En
somme, nous avons eu début juillet un coup de force, un coup d'état
militaire en bonne et due forme mais pour les Occidentaux, ce n'était
pas un coup d'Etat ! C'est ainsi que depuis quelques mois, on sent dans
les relations internationales une sorte de distanciation polie sur tout
ce qui se passe que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie ou en Afrique
noire. On ne croit plus en rien et surtout plus au modèle démocratique
et aux bons sentiments humanitaires tant vantés dans les années 90.
L'incapacité
d'Obama à utiliser en juillet 2013 le terme de ''coup d'Etat'' pour
désigner la situation égyptienne fut rédhibitoire et augure d'une
certaine incapacité de l'Amérique à se repositionner idéologiquement, à
posséder et maîtriser un argumentaire crédible. Barak Obama ne pouvait
en effet utiliser officiellement le terme de ''coup d'état militaire''
car il aurait alors été mis dans l'obligation légale de couper l'aide
financière si vitale à l’Egypte. Les Etats-Unis étaient ainsi la victime
collatérale de leurs propres textes. Mais si un coup d'Etat n'est plus
un coup d'état, qu'est-ce alors que la démocratie et qu'est-ce qui
justifiera demain l'interventionnisme américain ?
Avec
la destitution violente de Morsi, l'Occident est entré dans une
nouvelle confusion politique car les Occidentaux aiment les concepts
clivants, aiment négocier à l'intérieur de paramètres clairs et surtout
veulent en permanence moraliser le politique pour ne pas culpabiliser
leurs turpitudes.
C'était
donc des insurgés contre des dictateurs, des fanatiques contre des
démocrates, des bons contre des méchants, des laïcs contre des
religieux. C'est pour eux une manière de mieux comprendre et
d'appréhender la politique extérieure et de l'expliquer à leurs
électeurs. On s'était habitué, avant l'Egypte, qu'un coup d'état
militaire était nécessairement ''mauvais'' et qu'un président élu serait
forcément le ''bon'', le seul légitime. Mais il y eut Morsi après, mais
qui s'en souvient, l'Algérie des années 91-92. Et si l'éviction de
Morsi justifiait demain, même dans un pays comme la France, le refus de
certains résultats électoraux. Quel que soit ce que l'on pense des
Frères Musulmans, ce sont eux qui remportèrent les élections
présidentielles. Leur formation était alors le parti le plus important
du Parlement égyptien et le second parti de ce Parlement n'était pas
celui des libéraux mais celui des salafistes, encore plus
fondamentalistes et radicaux que les Frères Musulmans.
Une démocratie à géométrie variable
Cette
confusion de l'attitude occidentale à l'égard des élections égyptiennes
s'est multipliée dans tout le Proche-Orient et en particulier en Syrie
où la France comme les Etats-Unis ont soutenu les rebelles les plus
fanatiques au nom de la ''démocratie''. S’agissant de l'Egypte, certains
commentateurs ont prétendu que l'Egypte, après tout, n'était pas mûre
pour la démocratie ou pire que finalement, la démocratie n'était pas une
bonne solution pour l'Egypte, qu'elle n'y était pas préparée ! Mais
quel pays est-il donc prêt pour la démocratie ? En somme, le discours de
la paix démocratique, le discours de l'idéologue Christopher Layne
n'était que du vent. Pourtant tout le conflit afghan fut justifié par le
discours démocratique. Toutes les interventions africaines ont été,
jusqu'à aujourd'hui, des interventions pro-démocratiques. C'est donc le
coup d'état militaire de Sissi qui a stoppé ce grand élan de générosité
démocratique car pour une fois, un coup d'état n'était pas un coup
d'état mais une affaire démocratique!
L'écho
des évènements égyptiens qui nous parvient est comme brouillé par la
sensation incommode d'une belle duperie. Avec l'Egypte, avec la Syrie,
avec les pressions sur Gaza, l'Occident se dirige petit à petit vers le
chaos moral de l'intervention sans une once de justification. On se
retrouve exactement comme au temps de la Guerre froide lorsque les
Etats-Unis et ses alliés justifiaient les coups de force d'Asie ou les
dictatures d'Amérique latine, les préférant à toute autre alternative
sociale sauf qu'à cette époque, les progressistes chantaient la
révolution sur des vers de Neruda et dénonçaient les dictateurs et les
tyrans dans les films de Godard ? Or qui, aujourd'hui, lève le petit
doigt contre Sissi, le dictateur-maréchal égyptien ? En tout cas, les
événements égyptiens nous enseignent ce sur quoi nous insistons toujours
ici : on ne peut en politique internationale éviter la complexité, le
confus et les compromissions de toutes sortes. La politique
internationale n'est pas morale et ne le sera jamais.
